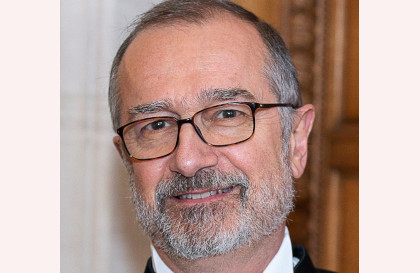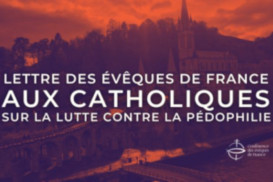La formation des prêtres
Le réponse du pape François à Mgr Marx

La réponse du pape François à la lettre de démission de Mgr Marx.
Deux beaux textes à méditer
Cher frère,
Tout d’abord, merci pour ton courage. C’est un courage chrétien qui n’a pas peur de la croix, qui n’a pas peur d’être humilié face à la terrible réalité du péché. Et c’est ce que le Seigneur a fait (Ph 2,5-8). C’est une grâce que le Seigneur t’a donnée et je vois que tu veux la saisir et la garder pour qu’elle porte du fruit. Merci.
Tu me dis que tu traverses une période de crise ; non seulement toi mais aussi l’Église en Allemagne. Toute l’Église est en crise à cause de l’affaire des abus. De plus, l’Église d’aujourd’hui ne peut faire un pas en avant sans affronter cette crise. La politique de l’autruche ne mène nulle part, et la crise doit être assumée à la lumière de notre foi pascale. Les sociologismes et les psychologismes sont inutiles. Affronter la crise, personnellement et en communauté, est la seule voie fructueuse, car on ne sort pas d’une crise seul, mais en communauté. Gardons aussi à l’esprit que nous sortons d’une crise soit meilleur soit pire, mais jamais indemne (1).
Tu me dis que tu y réfléchis depuis l’année dernière : tu t’es mis en route, cherchant la volonté de Dieu avec la résolution de l’accepter quelle qu’elle soit.
Je suis d’accord avec toi pour qualifier de catastrophe la triste histoire des abus sexuels et la façon dont l’Église les a traités jusqu’à récemment. Prendre conscience de cette hypocrisie dans la manière de vivre la foi est une grâce, c’est un premier pas que nous devons faire. Nous devons prendre en charge l’histoire, à la fois personnellement et en tant que communauté. Nous ne pouvons rester indifférents face à ce crime. L’assumer, c’est se mettre en crise.
Tout le monde ne veut pas accepter cette réalité, mais c’est le seul moyen, car prendre des « résolutions » pour changer sa vie sans « mettre la chair sur le gril » ne mène à rien. Les réalités personnelles, sociales et historiques sont concrètes et ne doivent pas être assumées par des idées ; parce que les idées sont discutées (et il est bon qu’elles le soient) mais la réalité doit toujours être assumée et discernée. Il est vrai que les situations historiques doivent être interprétées avec les particularités de l’époque où elles se sont produites, mais cela ne nous dispense pas de les prendre en charge et de les assumer comme l’histoire du « péché qui nous enveloppe ». C’est pourquoi, à mon avis, chaque évêque de l’Église doit l’assumer et se demander : que dois-je faire face à cette catastrophe ?
Toute réforme commence par soi-même.
Le « mea culpa » face à tant d’erreurs historiques du passé, nous l’avons fait plus d’une fois dans de nombreuses situations même si nous n’avons pas personnellement participé à cette circonstance historique. Et c’est cette même attitude qui nous est demandée aujourd’hui. On nous demande une réforme qui, dans ce cas, ne consiste pas en des mots mais en des comportements qui ont le courage d’affronter la crise, d’assumer la réalité quelles qu’en soient les conséquences. Et toute réforme commence par soi-même. La réforme sans l’Église a été faite par des hommes et des femmes qui n’ont pas eu peur d’entrer en crise et de se laisser réformer par le Seigneur. C’est la seule voie possible, sinon nous ne serons que des « idéologues de la réforme » qui ne mettent pas leur propre chair en jeu.
Le Seigneur n’a jamais accepté de faire « la réforme » (permets-moi d’utiliser l’expression) ni avec le pharisien, ni avec le sadducéen, ni avec le zélote, ni avec l’essénien. Il l’a fait avec sa vie, avec son histoire, avec sa chair sur la croix. Et c’est la voie, la voie que tu as toi-même, cher frère, assumée en présentant ton renoncement.
Tu dis à juste titre dans ta lettre que le fait d’enterrer le passé ne nous mène à rien. Le silence, les omissions, le fait de donner trop de poids au prestige des institutions ne conduisent qu’à l’échec personnel et historique, et nous amènent à vivre avec le fardeau d’ »avoir des squelettes dans le placard », comme le dit l’adage.
C’est le chemin de l’Esprit que nous devons suivre, et le point de départ est l’humble confession : nous avons commis une erreur, nous avons péché.
Il est urgent de « ventiler » cette réalité des abus et de la manière dont l’Église a procédé, et de laisser l’Esprit nous conduire au désert de la désolation, à la croix et à la résurrection. C’est le chemin de l’Esprit que nous devons suivre, et le point de départ est l’humble confession : nous avons commis une erreur, nous avons péché. Ni les sondages ni le pouvoir des institutions ne nous sauveront. Nous ne serons pas sauvés par le prestige de notre Église, qui a tendance à dissimuler ses péchés ; nous ne serons pas sauvés par le pouvoir de l’argent ou l’opinion des médias (nous sommes si souvent trop dépendants d’eux). Nous serons sauvés en ouvrant la porte à Celui qui peut le faire et en confessant notre nudité : « j’ai péché », « nous avons péché »… et en pleurant, et en balbutiant du mieux que nous pouvons cet « éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur », un héritage que le premier Pape a laissé aux Pontifes et aux Évêques de l’Église. Et alors nous ressentirons cette honte qui guérit et qui ouvre les portes à la compassion et à la tendresse du Seigneur qui est toujours proche de nous. En tant qu’Église, nous devons demander la grâce de la honte, et que le Seigneur nous évite d’être la prostituée éhontée d’Ézéchiel 16.
J’aime la façon dont tu termines ta lettre : « Je continuerai volontiers à être prêtre et évêque de cette Église et je continuerai à m’impliquer au niveau pastoral aussi longtemps que je le jugerai raisonnable et opportun. Je voudrais consacrer les prochaines années de mon service de manière plus intense à la pastorale et m’engager pour un renouveau spirituel de l’Église, comme vous le demandez inlassablement ».
Et voici ma réponse, cher frère. Continue comme tu le proposes, mais en tant qu’archevêque de Munich et Freising. Et si tu es tenté de penser que, en confirmant ta mission et en n’acceptant pas ta démission, cet évêque de Rome (ton frère qui t’aime) ne te comprend pas, pense à ce que Pierre a ressenti devant le Seigneur lorsque, à sa manière, il Lui a présenté sa démission : « Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur », et écoute la réponse : « Fais paître mes brebis ».
Avec une affection fraternelle,
FRANCISCO.
La lettre de démission du cardinal Marx
Un texte courageux, qui pose la question des “erreurs” systémiques de l’Eglise face au scandale des abus sexuels

Lettre du card. Reinhard Marx
Saint-Père,
Nul doute que l’Eglise en Allemagne traverse des moments de crise. Certes, il y a de nombreux motifs – y compris ailleurs qu’en Allemagne dans le monde entier – que je ne pense pas devoir ici énumérer en détail. Toutefois, la crise est causée par notre échec personnel, par notre faute. Cela m’apparaît de plus en plus nettement si je regarde l’Eglise catholique en général et cela, pas seulement aujourd’hui, mais également en référence aux dernières décennies. Il me semble – et ceci est mon impression – que nous sommes arrivés à un « point mort », mais qui pourrait aussi devenir un tournant selon mon espérance pascale. La « foi pascale » vaut également pour nous, évêques, dans notre charge pastorale : Qui veut sauver sa vie la perdra ; qui la perdra la sauvera !
Depuis l’année dernière, je réfléchis à sa signification pour moi personnellement et, encouragé par le temps pascal, j’en suis arrivé à la conclusion de vous prier d’accepter ma renonciation à la charge d’archevêque de Munich et Freising.
Il s’agit pour moi, en substance, d’assumer la coresponsabilité de la catastrophe des abus sexuels commis par les représentants de l’Eglise au cours des dernières décennies. Les enquêtes et les expertises de ces dernières années me montrent constamment qu’il y a eu à la fois des échecs au niveau personnel et des erreurs administratives, mais également une défaillance institutionnelle et « systématique ». Les polémiques et discussions plus récentes ont montré que certains représentants de l’Eglise ne veulent pas accepter cette coresponsabilité ni par conséquent la faute commune de l’Institution. Par conséquent, ils refusent tout type de réforme et d’innovation en ce qui concerne la crise liée aux abus sexuels.
Je vois les choses de façon totalement différente. Il y a deux éléments qui ne doivent pas être perdus de vus : les erreurs personnelles et l’échec institutionnel qui exigent des changements et une réforme de l’Eglise. Un tournant pour sortir de cette crise ne peut être, à mon avis, que la « voie synodale », une voie qui permet vraiment le « discernement des esprits », comme vous l’avez toujours souligné et écrit dans votre Lettre à l’Eglise en Allemagne.
Je suis prêtre depuis quarante-deux ans et évêque depuis presque vingt-cinq ans, dont vingt ans comme Ordinaire d’un grand diocèse. Je ressens douloureusement la baisse d’estime à l’égard des évêques dans la perception ecclésiastique et séculière ou plutôt celle-ci a probablement atteint son point le plus bas. Pour assumer la responsabilité, selon moi, il n’est pas suffisant de réagir uniquement au moment où l’on réussit à identifier, sur la base des actes, qui sont les responsables individuels et quelles sont leurs erreurs et leurs omissions. Il s’agit plutôt de préciser qu’en tant qu’évêques, nous voyons l’Eglise dans son ensemble.
En outre, il n’est pas possible de reléguer simplement les remontrances au passé et aux fonctionnaires d’alors et ainsi de « les enterrer ». Personnellement, je sens ma faute et ma coresponsabilité notamment dans le silence, les omissions et le poids donné au prestige de l’Institution. Ce n’est qu’après 2002 et, par la suite, de manière plus intense à partir de 2010, qu’ont émergé les responsables des abus sexuels. Toutefois, ce changement de perspective n’est pas encore arrivé à son accomplissement. La négligence et le désintérêt pour les victimes ont certainement été notre plus grande faute dans le passé.
Après le projet scientifique (étude MHG) sur les abus sexuels sur les mineurs, commandité par la Conférence épiscopale allemande, j’ai affirmé dans la cathédrale de Munich que nous avions échoué, mais qui est ce « nous » ? Certes, j’en fais partie moi aussi. Et cela signifie que je dois en tirer des conséquences personnelles. Ceci est de plus en plus clair pour moi.
Je crois qu’une possibilité d’exprimer ma volonté d’assumer des responsabilités est ma démission. Je pourrai ainsi probablement donner un signal personnel pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ de l’Eglise et pas seulement en Allemagne. Je veux montrer que ce n’est pas la charge qui est au premier plan, mais la mission de l’Evangile. Cela fait aussi partie de la pastorale.
C’est pourquoi je vous prie vivement d’accepter ma démission.
Je continuerai avec plaisir à être prêtre et évêque de cette Eglise et je continuerai de m’engager au niveau pastoral toujours et comme vous le jugerez bon et opportun. Je voudrais consacrer plus intensément les années à venir de mon service à la pastorale et m’engager pour un renouveau spirituel de l’Eglise, comme vous y exhortez inlassablement.
Oboedientia et Pax e oremus pro invicem
Nelly Vallance répond au questionnaire de promesses d’Eglise

Nelly Vallance a une double formation d’ingénieur et de sciences politiques, orientée vers le domaine de l’énergie. Engagée au MRJC depuis 10 ans, elle en est la présidente depuis l’été 2020
« Maintenant, il va falloir apprendre à dialoguer »
-
Dans sa Lettre au Peuple de Dieu, le pape François appelle à une transformation ecclésiale et sociale qui passe par un refus de toute forme de cléricalisme. Quel lien faites-vous entre transformation ecclésiale et sociale ?
Il y a un parallèle entre ce qui se passe dans l’Eglise et ce qui se passe dans la société. Nous avons besoin de lutter dans la société contre différentes formes d’oppressions. Le MRJC y est engagé, notamment pour combattre les discriminations en fonction du genre, de l’âge ou de l’origine territoriale. Il y a partout des rapports de pouvoir qui peuvent donner lieu à des abus. L’Eglise n’est pas étrangère aux relations déséquilibrées ; entre clercs et laïcs, entre sachant·e·s et écoutant·e·s, les rapports de pouvoirs sont réels et de nombreux abus liés à ce déséquilibre ont été révélés ces dernières années.
Nous luttons pour une société juste et équitable et cette exigence d’équilibre des relations nous la situons dans l’Eglise au même titre que dans le reste de la société.
-
Quels domaines ou quelles évolutions vous paraissent prioritaires aujourd’hui ?
Le pape parle de synodalité, de marcher ensemble. Ce qui importe alors c’est que chacun·e puisse tenir sa place dans ce cheminement. Il s’agit de faire de la place pour les laïcs, pour les femmes, pour les jeunes, pour les personnes vulnérables, etc. Cela passe par une manière de s’écouter, par la reconnaissance de la façon de faire et de croire de chacun·e. Une Eglise qui est capable d’accueillir tout un chacun, une Eglise plurielle et ouverte.
-
Quels obstacles ou quels points de vigilance voyez-vous sur ce chemin de la transformation ?
La difficulté est de se mettre tou·tes autour de la table et de dialoguer. C’est indispensable pour avancer ensemble. Mais dans l’Eglise comme ailleurs, il y a aussi des freins face au changement. La force de Promesses d’Eglise est déjà de mettre tout le monde autour de la table : des mouvements et communautés qui ont des manières de vivre l’Evangile de manière très variées, ainsi que les évêques. Maintenant, il va falloir apprendre à dialoguer en respectant nos différences et en abordant des sujets qui ne font pas l’unanimité. L’étape suivante sera de se dire ce que le dialogue transforme de notre perception des choses et notre manière de faire Eglise, et quelle inspiration nous en retenons pour demain.
-
Quel signe ou quelle expérience concrète vous fait dire que cette transformation est déjà en marche ou en tout cas possible ?
Promesses d’Eglise est déjà un signe du changement. La démarche n’en est qu’à ses débuts, mais le collectif rassemble des mouvements, communautés et associations de tous horizons en lien avec la CEF. Nous y retrouvons le rôle de l’Eglise d’embrasser l’ensemble des baptisé·e·s dans une même Eglise, malgré les divergences de charisme. Nous pouvons y parler librement dans notre pluralité, dans un climat de respect et de paix. Le chemin pour aboutir à une Eglise synodale est encore long, mais le fait qu’un espace de dialogue existe déjà est encourageant.
Emmanuel Belluteau répond au questionnaire de promesses d’Eglise

Conseiller-maître à la Cour des comptes, président de l’office chrétien des personnes handicapées, fort de diverses expériences de la fragilité, notamment comme expert du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe, Emmanuel Belluteau est l’auteur de plusieurs livres.
Il vient de publier : “Dessine-moi une Eglise Un état des lieux avant travaux”
« Une Eglise qui accueille et apprend à recevoir »
1) Dans sa Lettre au Peuple de Dieu, le pape François appelle à une transformation ecclésiale et sociale qui passe par un refus de toute forme de cléricalisme. Quel lien faites‑vous entre transformation ecclésiale et sociale ?
La question du cléricalisme se pose, pour la société et pour l’Eglise, dans des termes étonnamment similaires, mais avec aussi de fortes singularités.
On en trouve la trace dans toutes les sociétés humaines, qui n’échappent pas à un penchant irrépressible à des comportements de domination, d’accaparement ou de prééminence. Ce phénomène infantilise, exclut, étouffe les personnes, stérilise les initiatives et suscite beaucoup de frustrations.
Dans l’Eglise et dans la société, la solution est la même dans son principe : partager davantage l’information et les décisions, mieux organiser la participation des membres du groupe, consulter, associer, faire confiance. Avec en vue non seulement des motivations de reconnaissance mais surtout le souci de l’efficacité collective.
Cependant, les situations divergent en ce qui concerne la nature et les modalités de l’exercice des responsabilités. On attend légitimement des responsables de la société qu’ils exercent un pouvoir (de réglementation, de gouvernement, d’arbitrage, de commandement, etc.). Il s’agit pour eux de faire en sorte que les intérêts particuliers ne compromettent pas le respect de l’intérêt général. Dans l’Eglise, au contraire, pour laquelle l’objectif est le bien commun, celui de tous et de chacun en même temps, les relations ne devraient pas être de pouvoir mais d’autorité, au sens où il est dit que Jésus « enseignait avec autorité », c’est‑à-dire, si on se rapporte à l’étymologie, par une Parole qui fait croître. Ainsi conçue, l’autorité aide à grandir et libère, alors que le pouvoir – qui nourrit le cléricalisme – abaisse inévitablement et porte à l’abus du même nom.
C’est pourquoi l’enjeu n’est pas, dans l’Eglise, de transférer du pouvoir des clercs aux laïcs mais de dégager le plus possible l’Eglise des logiques de pouvoirs et contre‑pouvoirs. Dépasser le cléricalisme suppose dès lors de travailler à la meilleure implication possible de tous, les clercs au premier chef – si l’on peut dire ! – avec le souci d’un fonctionnement non pas démocratique mais fraternel.
2) Quels domaines ou quelles évolutions vous paraissent prioritaires aujourd’hui ?
Pour l’Eglise, deux séries de préoccupations, complémentaires, me paraissent constituer les priorités du moment.
La première est extérieure et il s’y attache un enjeu d’image. Nous devons davantage montrer le vrai visage de l’Eglise, celui des Béatitudes. Et manifester sa vocation à être présente aux côtés des hommes et des femmes de son temps, non pas pour leur faire la morale, mais pour les accompagner ; partager avec eux les joies et les peines ; donner du sens à ce qu’ils vivent et leur montrer, par l’exemple plutôt que par les mots, comment faire place à ce qui nous dépasse tous, établit la dignité singulière de chaque personne et nous réunit dans une commune fraternité : l’amour que le Père nous porte.
L’Église doit retrouver sa capacité originelle à dire ce qui est bon pour l’homme et le rend vraiment libre. Une Église qui accueille, qui donne (ce qu’elle a toujours su faire) et apprend à recevoir (ce qui lui a toujours été très difficile).
La seconde évolution qui s’impose est interne à nos communautés paroissiales et diocésaines, et elle porte un enjeu de fraternité et d’unité. Non pas cette forme d’unité qui consiste à nier les différences, à placer la multitude derrière l’étendard d’un seul, réputé plus inspiré, méritant ou légitime, mais une communion, faite de partage et de complémentarité, en vertu de laquelle tous sont appelés, chacun à sa place, à participer à la définition et à la réalisation de la mission. Il y a une urgence très grande à ce que nous apprenions à vivre entre nous une collégialité fraternelle authentique.
Pour répondre à ces impératifs, nous ne devons pas cesser d’inventer l’Eglise dont le monde a besoin, une Église qui donne envie et annonce la joie, qui témoigne et ose, qui proclame la Vérité et la fait, une Église qui sache non seulement exhorter mais aussi davantage remercier, féliciter, encourager et laver les pieds de ceux qu’elle accueille. Notre mode de communication descendant participe du décrochage qui s’accélère avec la majorité de nos contemporains. Plutôt que de nous limiter à leur adresser des messages, nous pourrions plus systématiquement commencer par les interroger sur leurs attentes et leurs besoins, leurs peurs et leurs espoirs, leurs doutes et leurs suggestions, et ouvrir avec eux un dialogue, un vrai dialogue.
3) Quels obstacles ou quels points de vigilance voyez-vous sur ce chemin de la transformation ?
Quand il se manifeste sur le chemin d’Emmaüs, Jésus se révèle à Cléophas et à un autre disciple, auquel l’Église nous invite à nous identifier. Trois caractéristiques mises en exergue par l’attitude de ces hommes pourraient bien être les conditions d’une transformation bien « équilibrée » de l’Eglise : ils sont en marche ; ils s’interrogent ; et ils échangent.
Il est urgent que nous réalisions que nous sommes tous, fraternellement avec les prêtres et les autres fidèles, à la fois comptables de ce que sera l’Église demain et, surtout, invités à ce que notre vie de foi, personnelle et communautaire, soit ce cheminement chaque jour prolongé et en recherche, et pas une réponse trouvée une fois pour toutes. Cela demande sûrement quelques ajustements dans l’organisation et le fonctionnement de l’Église universelle, de nos diocèses et de nos paroisses. Mais il en va avant tout de notre propre responsabilité et de notre crédibilité. Il suffirait qu’une partie de ces « observateurs » que nous sommes et qui constituent le gros des troupes n’oublie pas de continuer de se lever, d’échanger et de s’interroger, comme Jésus y invite ses disciples, pour que les responsabilités se trouvent mieux partagées.
La transformation de l’Eglise doit aller au-delà de certaines habitudes que nous avons érigées en dogmes. C’est pourquoi, il faut procéder avec résolution mais délicatesse, à la fois rassurer et encourager. Les prêtres doivent être convaincus qu’ils n’ont rien à perdre (on ne devrait jamais raisonner en ces termes !) mais au contraire tout à gagner à pouvoir s’appuyer sur des communautés plus engagées et responsabilisées. Mais les paroissiens ordinaires que nous sommes tous doivent consentir à s’extraire de cette sorte de léthargie qui s’est emparée, reconnaissons-le, de beaucoup de nos assemblées. Une difficulté importante vient aussi de ce que nombre de catholiques pratiquants inscrivent encore leur rapport avec l’Église dans une logique de type hiérarchique, en vertu de laquelle les prêtres sont sacralisés et seuls détenteurs de l’autorité légitime.
4) Quel signe ou quelle expérience concrète vous fait dire que cette transformation est déjà en marche ou en tout cas possible ?
La plus grande chance de l’Église, c’est la diversité incroyable et féconde de ses membres.
Ce qui se vit dans les associations ou mouvements œuvrant auprès de personnes fragiles, malades ou handicapées est un exemple intéressant de la manière dont une communauté peut s’épanouir, sans qu’il y ait besoin d’un plan de bataille ou de mesures radicales. Bon nombre de ceux qu’on y rencontre font partie de ces fameux imparfaits, pauvres ou tout‑petits dont Jésus nous assure que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. La plupart ont peu de capacités au regard des critères habituels de l’utilité, de l’efficacité ou de la performance, et généralement peu de facultés à participer à la vie ordinaire ; alors a fortiori à l’édification spirituelle de la collectivité ! Pourtant, contre toute logique, ce que nous partageons avec eux nous ramène malgré nous au cœur du message évangélique. Parce que nous sommes simplement réunis au nom du Christ, petits, imparfaits, blessés par des épreuves devant lesquelles nous sommes souvent impuissants et interrogatifs, nous faisons l’expérience vivante de cette fraternité authentique en vertu de laquelle ceux qui donnent sens à nos assemblées sont toujours les plus fragiles et les plus « incapables ». Une fraternité très banale et à la portée de tous, profondément spirituelle et en quête de sens, inventive, audacieuse et fidèle.
Si l’Église s’appliquait à redevenir le lieu privilégié de ce questionnement et de cette espérance, de cette fraternité pour les nuls, dans laquelle chacun compte sur chacun, il ne fait pas de doute qu’elle pourrait de nouveau – autrement qu’hier et aujourd’hui – être à la hauteur de sa vocation évangélique de briller aux yeux du monde et d’être le sel de la terre.
Claude Besson répond au questionnaire de promesses d’Eglise

Claude Besson, 68 ans, vivant à Nantes, engagé au CCFD-Terre Solidaire depuis plus de 30 ans, actuel président de la délégation de Loire-Atlantique et membre du Conseil d’administration)). Membre d’une Équipe d’Animation Pastorale, officiant de funérailles. Membre de la Conférence Catholique des Baptisés de Loire-Atlantique (CCB44).
« Je crois en l’intelligence collective »
-
Dans sa Lettre au Peuple de Dieu, le pape François appelle à une transformation ecclésiale et sociale qui passe par un refus de toute forme de cléricalisme. Quel lien faites-vous entre transformation ecclésiale et sociale ?
Il est clair qu’il ne peut y avoir de transformation ecclésiale réelle sans une lutte contre le cléricalisme et tous les abus quel qu’ils soient. C’est une réforme de fond qui doit être engagée dans tous les milieux ecclésiaux (paroisses, mouvements et services d’Eglise etc…). Engagé au CCFD-Terre Solidaire depuis longtemps, je suis très sensible à la transformation sociale pour que chaque être humain puisse vivre dans la dignité. Le CCFD-Terre Solidaire a engagé depuis plusieurs années une démarche de démocratie participative et cette démarche est essentielle aussi bien pour la société que pour l’Eglise catholique. Les chrétiens engagés dans ce monde participent à la transformation sociale. Et de fait, cette transformation sociale peut influer sur la transformation ecclésiale. Si on ne peut assimiler l’Eglise à une démocratie, l’Eglise ne peut exister sans débat, sans dialogue réel avec tous les baptisé.es dans une démarche synodale que le pape François appelle de ses vœux.
-
Quels domaines ou quelles évolutions vous paraissent-elles prioritaires aujourd’hui ?
Pour ma part, le domaine prioritaire, c’est le domaine du sacré.
Je rejoins en ce sens la parole de plusieurs théologiens, comme celle de Jean-Pol Gallez : « La véritable pierre d’achoppement aujourd’hui , c’est le rapport au sacré, chaque chrétien doit s’interroger : en quel Dieu je mets ma confiance ? Quelle est ma conception du christianisme ? Si ce verrou du sacré est débloqué, je pense que toute cette créativité, cette inventivité des premiers siècles, peut à nouveau rejaillir aujourd’hui et ouvrir à de nouvelles formes peut-être inattendues de célébrations et de vie en Église. ».
On l’a vu récemment au sujet de la fermeture du centre pastoral de St Merry à Paris. Même avec une volonté de « réelle » collaboration entre prêtres et laïcs, cela ne fonctionne pas avec la structure actuelle où tout est concentré entre les mains d’un curé ou d’un prêtre qui assure la fonction du sacré et qui est donc quelque part intouchable. Et je suis témoin que dans bien d’autres lieux moins médiatisés, les difficultés sont les mêmes. Cela engendre des souffrances de part et d’autre, des départs, des découragements… Le cléricalisme est lié, il me semble, à la question du sacré, même si le cléricalisme n’est pas l’exclusivité des prêtres mais existe aussi chez des laïcs en responsabilité.
J’entends souvent dans des conférences sur le sujet du cléricalisme : « Il faut revenir à l’Évangile ». Oui, j’en suis conscient d’autant que « l’Évangile annule le sacré religieux et le déplace, éthiquement, vers l’être humain. Et j’ajoute que rien dans le Nouveau Testament ne permet d’instituer un clergé hiérarchique, distinct des autres croyants » (Dominique Collin, théologien et dominicain)
-
Quels obstacles ou quels points de vigilance voyez-vous sur ce chemin de la transformation ?
Cela rejoint la question précédente. Dans pratiquement tous les diocèses en France, en raison de la diminution du nombre de prêtres, le choix d’agrandir le périmètre des paroisses en les regroupant a été fait. Dans le diocèse de Nantes, il y a encore quelques années, huit paroisses étaient sous la responsabilité d’une équipe missionnée de laïcs avec un prêtre modérateur. Je me réjouissais de cette approche qui envisageait l’avenir de l’Eglise, pas simplement appuyée sur les prêtres, mais aussi sur la richesse de l’ensemble des baptisés. Malheureusement, aujourd’hui, il n’y a plus que 3 paroisses dans cette situation. Pourtant, ce schéma de « gouvernance » paroissiale mérite d’être approfondi.
Penser l’avenir, c’est ne plus réfléchir à partir du seul prêtre, mais à partir de la communauté chrétienne. De nombreux articles sont publiés en ce sens par d’imminents théologien.es ou autres. Pourquoi ne peut-on aujourd’hui faire quelques avancées dans ce domaine, en tentant des expériences nouvelles “… J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés…” (in “La joie de l’Évangile“, n°33)
-
Quel signe ou quelle expérience concrète vous fait dire que cette transformation est déjà en marche ou en tout cas possible ?
Au-delà des drames provoqués par la pandémie (du point économique, social et autres…), il y a eu une réflexion, une recherche qui a émergé pour revenir à l’essentiel. Et cette réflexion, ces prises de parole viennent de milieux divers et parfois des « hautes autorités ». Je pense aux leçons tirées par le Cardinal Mario Grech, le nouveau secrétaire du Synode des Evêques, : il disait que nous avions oublié qu’il y avait bien d’autres manières de faire l’expérience de Dieu que par la célébration des sacrements.
Des réalités existent à l’autre bout du monde, comme à Altamira, au cœur de l’Amazonie, où l’évêque local a confié à six religieuses la gestion d’une aire pastorale importante et ces religieuses administrent les sacrements.
La réflexion est en marche… Repenser la gouvernance de l’Eglise en y associant tous les baptisé.es dans une démarche synodale pourrait faire surgir des idées auxquelles on n’avait pas pensé. Je crois à l’intelligence collective. Au niveau de l’Eglise de France, cela me paraît complexe, tellement les diocèses sont différents, mais au niveau de chaque diocèse, je pense que cela peut se mettre en place. Il suffit d’avoir cette volonté, cette audace et aussi cette confiance en l’Esprit Saint qui habite le cœur de tout être humain. Nous ne connaissons pas l’avenir, mais nous avons le devoir de tout faire pour qu’il puisse exister.
Claude Besson
Lettre des évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie
Vous pourrez retrouver le document de la CEF adressé aux catholiques de France en suivant ce lien
Il nous concerne tous