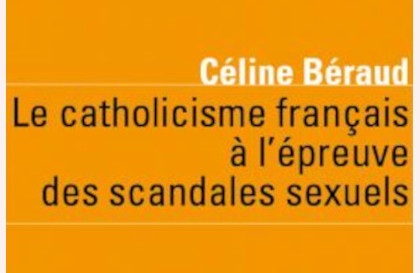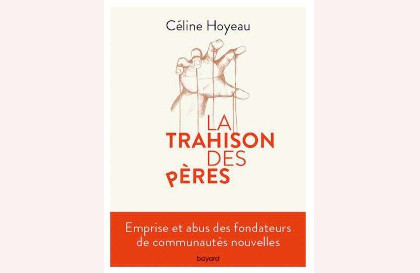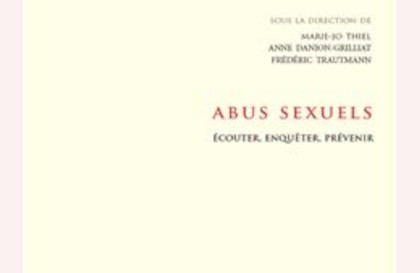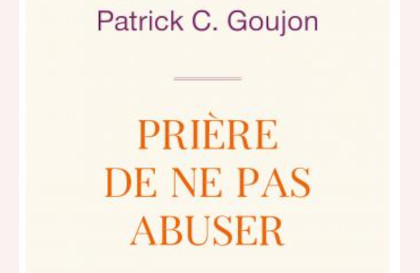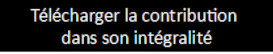La formation des prêtres
Le catholicisme français à l’épreuve des scandales sexuels
Recension parue dans la revue Etudes
Céline Béraud
Le catholicisme français à l’épreuve des scandales sexuels
Seuil, « La République des idées », 2021, 112 pages, 11,80 €.
Dans ce livre court et fluide, Céline Béraud analyse les conséquences de la crise des abus sexuels de 2018-2020 sur les équilibres internes du catholicisme français. En termes d’affiliation, les scandales contribuent à nourrir la tendance lourde à la baisse, mais leur impact n’est peut-être pas si déterminant qu’on pourrait le penser spontanément. Certes, à la suite des révélations, certains fidèles ont fait défection, en refusant de continuer à endosser une identité catholique ou en cessant d’aller à la messe, sans pour autant couper tous les ponts: ils sont souvent venus grossir un « second cercle » qui maintient un lien plus ou moins distendu avec le catholicisme, à travers ses monastères, sa presse ou ses associations caritatives. Mais d’autres ont exprimé leur protestation de l’intérieur de l’institution, dans l’espoir de la rénover. Le discours de changement, qui avait été disqualifié sous le pontificat de Jean Paul II (mariage des prêtres, place des femmes, reformulation du discours sur la sexualité, etc.), retrouve une certaine audience, dans un contexte où le pôle conservateur de l’Église, très visible en 2012-2014 au moment du « Mariage pour tous », est déstabilisé par les révélations sur le double jeu de plusieurs de ses figures de proue. Les scandales constituent une « fenêtre d’opportunité » pour faire avancer des « revendications longtemps retenues, voire étouffées », dans un contexte où le pape François entrouvre la porte aux réformes, tout en promouvant une approche moins verticale de la gouvernance, le cléricalisme étant vu comme la principale cause des abus. Cette analyse sociologique permettra aux catholiques de mettre en perspective le moment qu’ils vivent et, aux autres, de mieux comprendre ce qui se joue actuellement dans le catholicisme.
Charles Mercier
La trahison des pères
Recension parue dans la revue Etudes
Céline Hoyeau
La trahison des pères
Emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles
Bayard, 2021, 280 pages, 19,90 €.
L’objet de ce livre est mentionné sur la page de garde en sous-titre: « Emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles ». Il est le fruit d’une enquête démarrée en octobre 2019, mais dont les origines vont beaucoup plus loin puisque Céline Hoyeau a fait partie de ces mouvements de jeunes qui vivaient l’aventure de la mission dans les années 2000, à l’initiative de Jean Paul II et de multiples fondateurs. L’auteure est croyante, proche de ces mouvements de renouveau mais, en même temps, « meurtrie par toutes ces affaires ». Utilisant de multiples interviews de témoins et de spécialistes, la journaliste de La Croix analyse les dérives spirituelles et sexuelles d’une quinzaine de fondateurs de communautés dans le cadre français et s’interroge. Dans une période de grandes mutations et d’incertitude de l’Église, des esprits inspirés ont pu drainer de nombreux adeptes impressionnés, voire aveuglés, par des charismes qui semblaient promettre un nouveau printemps de la foi. La hiérarchie ecclésiale, souvent divisée et hésitante, n’a pas su gérer cette foison de nouveautés, aveuglée par les fruits apparemment si remarquables. Au fil des pages, l’auteure examine de nombreux cas concrets, Jean Vanier, le frère Éphraïm (Gérard Croissant), Thierry de Roucy et spécialement les frères Thomas et Marie-Dominique Philippe, sur lesquels elle apporte de précieuses informations historiques et théologiques.
Pierre de Charentenay
Abus Sexuels
Recension parue dans la revue Etudes
Marie-Jo Thiel, Anne Danion-Grilliat et Frédéric Trautmann (dir.)
Abus sexuels
Écouter, enquêter, prévenir. Presses universitaires de Strasbourg, « Chemins d’éthique », 2022, 438 pages, 28 €.
À lui seul, le titre évoque un manifeste, les attitudes requises face aux agressions sexuelles et abus spirituels et de pouvoir de toutes sortes. Si les directeurs de l’ouvrage ont ciblé le monde ecclésial, le volume est loin de s’y restreindre. Pour comprendre les multiples questions que pose ce type de violence, il fallait réunir des spécialistes de nombreuses disciplines et élargir l’approche aux démarches du soin, de la justice et de la prévention. Ce regard croisé est le seul possible pour traiter de ce type de violence, en raison de « l’hybridation réciproque des causes ». En partant des victimes, la première partie explore la nature des traumatismes, d’un point de vue psychique et somatique. Elle se poursuit en éclairant ce que sont les abus spirituels et le contexte pastoral et culturel de ces agressions. La deuxième partie apporte une lumière précieuse sur l’encadrement juridique civil et canonique, la difficulté des procédures et la connaissance que la justice acquiert des modes d’opérer des agresseurs. Sans masquer les limites de la justice, et la nécessité d’aborder par des commissions interdisciplinaires le phénomène (voir la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église [Ciase]), la troisième partie se consacre ensuite au chantier de la prévention, qui commence par l’identification des terrains abusifs et par l’élaboration d’actions qui attendent aussi encore urgemment d’être mises en œuvre. Bref, une somme qui ne se veut en rien définitive.
Patrick C. Goujon
J’écouterai leur cri
Recension parue dans la revue Etudes
Monique Baujard, Geneviève Comeau, Joëlle Ferry, Thérèse de Villette, Agata Zielinski
J’écouterai leur cri
Cinq regards de femmes sur la crise des abus. La Xavière – Éditions Emmanuel, 2022, 172 pages, 18 €.
L’an dernier paraissait, aux mêmes éditions, un premier ouvrage collectif proposant « cinq regards de femmes sur la crise » (C’est maintenant le temps favorable, 2021). Le mot de « crise », à l’époque, se suffisait à lui-même : en pleine pandémie, et sortant tout juste d’un deuxième confinement sanitaire, il allait sans dire que nous avions basculé dans un régime de crise inédit. C’est donc avec un sentiment d’urgence, pour ne pas nous laisser nous enliser dans le désarroi, que s’était constitué un collectif de femmes, toutes religieuses xavières, non pour dénoncer les travers dont résultait la crise ni s’enthousiasmer du « monde d’après », mais pour mettre en lumière les ressources insoupçonnées dont nous disposions déjà. Or, par une triste coïncidence, la publication quelques mois plus tard du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), qui révélait l’ampleur et la nature systémique de la pédocriminalité dans l’Église catholique, fit plonger celle-ci dans une crise au moins aussi profonde. Les xavières sont alors revenues à la charge avec la même recette, recomposant un collectif pour la circonstance, élargi à une laïque, Monique Baujard. Pourtant, le mot d’ordre n’était plus de « ne pas se laisser abattre » : chacune des contributrices se livre ici sur la façon dont la révélation des abus l’a ébranlée aux entrailles. Et c’est justement cet ébranlement qui les pousse à trouver en elles les ressources pour venir en aide au peuple des fidèles, puisant chacune dans son bien propre afin de ne pas les laisser à terre. Mais ces femmes ne se cantonnent pas à un rôle de Bon Samaritain, ni même de veuve à l’obole : en tant que membres à part entière du « corps du Christ », égorgé et pourtant debout, qu’est l’Église, elles témoignent des immenses ressources que celle-ci porte en elle, dès lors qu’elle prend conscience d’elle-même dans ses véritables dimensions.
Théophile Desarmeaux
Prière de ne pas abuser
Recension parue dans la revue Etudes :
Patrick C. Goujon
Prière de ne pas abuser
Seuil, 2021, 96 pages, 12 €.
Prière de ne pas abuser est un aveu intime et courageux. Patrick Goujon y révèle, avec pudeur, délicatesse, fragilité et force, non seulement ce qu’il a subi enfant, mais surtout l’expérience étonnante de déni qu’il a vécu jusqu’à une période encore récente. L’homme confie, dans ce court récit, très personnel, ce qu’il aurait été moins engageant et exposant pour lui de taire. Il déploie, avec beaucoup de simplicité et de poésie, malgré la lourdeur du sujet, une parole, comprimée pendant des années dans son corps noué et meurtri par la charge de ce qu’un prêtre lui imposa de vivre, enfant. En abusant de lui, ce dernier lui brisa la vie et le corps, ce corps trop longtemps chargé du joug d’un déni qui s’est infiltré dans tous les tissus et les fibres de son être, donnant au mal qu’il a vécu une réalité physique, méconnaissable dans sa forme initiale. Un souffle puissant traverse ce récit de dévoilement. Patrick Goujon raconte comment des médecins, notamment, l’aidèrent à réaliser que ses douleurs physiques terrassantes pouvaient traduire des expériences traumatisantes oubliées, non : déniées ! Le chemin qu’il raconte est celui de la découverte de son déni, celui qu’il parcourt pour tenter de porter plainte contre ce criminel, connu de l’Église pour sa déviance pédophile, un temps au cours duquel des questions existentielles capitales l’assaillent et qui auraient pu le mener à renoncer à être prêtre. Mais le cœur de cet homme est un cœur de prêtre. Patrick Goujon témoigne de sa réconciliation avec lui-même, avec l’amour des autres, ces autres qui ont participé à l’aider, et surtout avec Celui qui sauve : le Christ. Ce texte magnifique bouleverse, parce que ni la haine ni l’amertume ne triomphent en lui. Patrick Goujon choisit d’épouser de nouveau ou plutôt de confirmer pleinement sa vocation, celle de l’Amour.
Camille Lacau St Guily