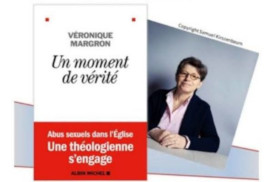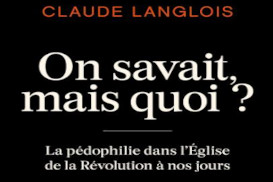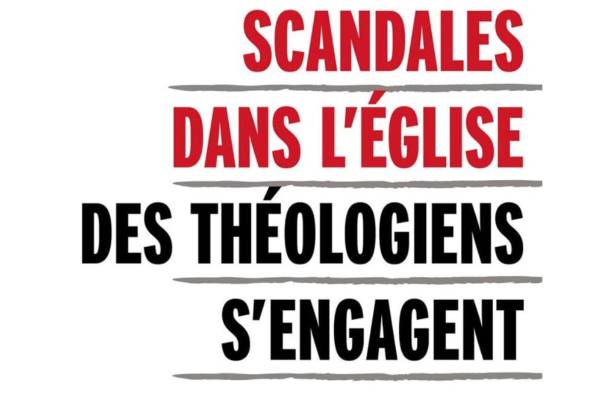La formation des prêtres
Intervention du père Etienne Grieu
Intervention du père Etienne Grieu, sj, lors de l’assemblée générale de promesses d’Eglise le 1er décembre 2020

Etienne Grieu est jésuite, professeur de théologie et recteur du centre Sèvres.
Bonsoir à vous. Merci pour cette invitation à participer à vos réflexions. Je dois dire que je suis très heureux de pouvoir être témoin des échanges au sein du groupe qui travaille sur la synodalité.
Ce que Christine, François et Nelly nous ont partagé, ce sont, il me semble, différentes manières de se mettre à l’écoute de Dieu :
-
de l’Esprit qui est à l’œuvre dans le monde, au-delà des seuls baptisés, comme on l’a entendu de Nelly Vallance, à partir, notamment de ces situations où il y va de la dignité de l’être humain ;
-
de l’Esprit qui parle en toute personne (et pas seulement chez les ténors) comme on l’a entendu dans ce qu’a dit Christine Danels en présentant cette manière de se mettre à l’écoute de l’Esprit dans les communautés de la Xavière ;
-
et puis, à travers ce que Françoise Michaud a dit sur l’importance de l’accompagnateur en ACI, on voit qu’il y a des figures instituées (ici, un accompagnateur) qui sont chargées d’ouvrir un groupe, une communauté, à l’altérité de Dieu.
Finalement à travers ces trois témoignages, on retrouve des fondamentaux sur la manière dont l’Eglise écoute son Dieu : par une attention aux signes des temps, par une écoute mutuelle dans les communautés où chacun peut partager quelque chose qui lui vient de Dieu ; et puis par une écoute d’une parole qui vient d’au-delà des cercles que nous formons, Parole de Dieu, notamment que des accompagnateurs ou des ministres nous aident à entendre.
Nous pouvons facilement, je crois, nous retrouver, tous les chrétiens sur ces points. Ils font écho à ce que nous avons entendu la fois dernière, et aux fondamentaux que Claire Anne Baudin a rappelés : l’universalité du travail de l’Esprit (au-delà, donc des seuls baptisés), l’égalité de dignité des baptisés, l’attente que tout chrétien puisse partager ce qui lui vient de Dieu.
Si nous sommes bien d’accord là-dessus, à la limite, on pourrait se dire : pourquoi faire un synode sur la synodalité ? S’il y a un problème, une question à travailler, où pourrait-il se situer ?
J’émets une hypothèse : ce qui, peut-être, est difficile à admettre, depuis les temps bibliques jusqu’à aujourd’hui, c’est que le don de Dieu circule dans tous les sens. Ça c’est difficile à admettre. Reconnaître le don de Dieu, pas de problème. Reconnaître qu’il passe par certains. Pas de problème. Mais ce serait quand même plus clair si, en gros, il passait toujours par les mêmes personnes bien identifiées. Alors, on pourrait repérer le flux de circulation du don de Dieu, à la limite on pourrait le cartographier comme on fait l’organigramme des responsabilités dans une entreprise. Seulement ça ne marche jamais comme cela. Déjà, dans une entreprise, l’organigramme n’est jamais strictement respecté ; mais à plus forte raison, Dieu semble mettre un malin plaisir à passer par où il veut, le plus souvent en dehors de tout ce qui était attendu.
Et cela donne lieu, dans la révélation biblique, à un phénomène quand même très présent, c’est le retournement des positions établies. La Bible en a tout à fait conscience, et elle joue sans cesse sur ce registre : regardez Jacob et Esaü, c’est le cadet qui se retrouve avec la bénédiction destinée à l’aîné ; regardez Juda et Thamar : un des fils de Jacob se fait recadrer par une femme qui s’est mise au rang des prostituées et Juda admettra : « elle est plus juste que moi » ; regardez Joseph et ses frères : celui qui est haï et vendu comme esclave se retrouve dans la position du bienfaiteur de ses frères ; regardez David, celui qu’on avait oublié de faire venir quand Samuel passait visiter la maison, c’est celui-là qui est oint ; et ensuite, quand il est roi, David lui-même est recadré par le prophète Nathan ; regardez le prophète Amos qui dit « je ne suis pas prophète ; je suis bouvier et pinceur de sycomore ; mais le Seigneur m’a pris de derrière le troupeau et il m’a dit ‘va prophétise à mon peuple Israël’ » ; regardez Jérémie, le prophète qui ne sait pas parler. Et dans le Nouveau Testament, regardez la femme pécheresse que Jésus donne comme exemple à Simon le pharisien ; regardez Bartimée qui devient le centre d’intérêt d’une scène où il n’avait pas de place ; regardez la veuve qui met ses deux piécettes dans le trésor du temple, plus que tout ce que les autres ont mis, dira Jésus ; regardez l’itinéraire de Jésus lui-même, qui descend jusqu’à la dernière des dernières places ; regardez l’annonce de la nativité faite aux bergers, et celle de la résurrection à des femmes : dans les deux cas, des témoins de 3e catégorie ; écoutez le Magnificat avec cette parole : « il renverse les puissants de leur trône, il élève, les humbles » ; écoutez les béatitudes ; écoutez « les premiers seront des derniers et les derniers seront les premiers ». Cela fait beaucoup non ? ça fait tellement qu’on ne peut pas y voir seulement une série d’accidents, ni non plus un effet littéraire destiné à encourager les petits, comme dans les contes. Bien plus, c’est l’indice qu’on a affaire à un élément de la structure de la révélation : quand Dieu nous parle, il nous parle comme cela ; il nous parle à l’envers de nos manières d’organiser notre monde ; quand il nous parle, il prend un malin plaisir à prendre à rebours les positions reconnues.
Non pas qu’il y aurait ici quelque chose de destructeur de l’ordre social ou politique. Non, mais peut-être un avertissement : si les hiérarchies que nous mettons en place jouent toujours à sens unique, elles pourraient bien stériliser le don de Dieu. Les hiérarchies, il y en a sans cesse dans le monde comme dans l’Eglise. Mais elles parlent de Dieu quand elles acceptent de se soumettre à ce retournement des asymétries : les premiers seront des derniers, les derniers seront les premiers. Claire Anne Baudin le disait déjà la dernière fois : l’économie du salut est incompatible avec des relations qui marchent à sens unique.
Et si l’on regarde l’histoire de l’Eglise, ça continue. Je ne cite que trois exemples : la Vierge Marie apparaît à Lourdes à une jeune fille qui n’a pas pu aller au catéchisme ni faire sa première communion, et son père est passé par la case « Prison » et la honte a frappé toute la famille ; la conversion de l’Eglise qui s’opérera lors du concile Vatican II est lancée par une jeune carmélite tuberculeuse qui meurt à 25 ans à Lisieux. Le pape François, le soir de son élection, s’inclinant devant la foule rassemblée place St Pierre, demande au peuple de Dieu de prier pour lui, se plaçant ainsi sous sa prière, si l’on peut dire.
Nos liturgies, elles aussi répondent à la même structure : la structure fondamentale de nos liturgies est responsoriale : « Le Seigneur soit avec vous / Et avec votre esprit » (on voit cela aussi bien dans de très brefs échanges comme celui-ci, mais plus largement, c’est la structure de toute la liturgie : le peuple de Dieu écoute sa Parole, et lui fait réponse). Et dans cette structure responsoriale, le pôle de l’autorité n’est pas figé : il se déplace. L’évêque qui préside écoute l’Evangile qui est lu par un diacre : au moment où le diacre lit, c’est celui-ci qui représente l’autorité de la présence de Dieu pour son peuple, et l’évêque est sous cette autorité.
Pourquoi Dieu s’y prend-il ainsi ? Je répondrais volontiers : parce qu’il chercher à établir une relation vivante avec son peuple. Et une relation vivante, par définition, ça marche dans les deux sens. Dieu quand il parle, appelle ; il espère une réponse, un « me voici ». Ecouter un « me voici », c’est faire toute la place à celui qui le prononce ; c’est le mettre en position haute, plus haute que soi. Sans ce jeu de bascule des asymétries, l’alliance serait un diktat où Dieu aurait simplement donné des consignes ; et l’on n’aurait pas vu naître un peuple de l’alliance.
Toute la question pour l’Eglise, sera de chercher des manières de faire fonctionner ses institutions de façon à rendre ces retournements possibles. Je ne dis pas que c’est facile ; et cela demande de le vouloir vraiment et de réfléchir aux moyens à prendre pour cela. Par exemple dans le témoignage de Christine Danels, on entend qu’il y a eu une recherche afin de trouver une manière de se mettre à l’écoute les unes des autres et qui permette à toutes de parler ; et aussi de laisser résonner en chacune ce qu’elles ont entendu de la part des autres ; d’où le fait de faire plusieurs tours : on parle, pas seulement pour dire ce que Dieu nous inspire, mais aussi pour écouter comment il inspire les autres : chacune est invitée à ce retournement des asymétries, à un niveau personnel.
A travers le témoignage de Françoise et sa réflexion sur la figure de l’accompagnateur, s’ouvre toute la question des ministères. Car un ministre, un serviteur de la communauté, c’est quelqu’un qui d’abord, veille à ce que cette circulation du don de Dieu soit la plus vivante possible dans la communauté. C’est donc quelqu’un qui renvoie chacun à sa relation à Dieu et à la manière dont il l’accueille quand il passe par les autres. Et si l’on doit parler à son propos d’une fonction de gouvernement (on emploie ce terme pour les ministres ordonnés) cela ne veut pas dire que c’est lui le chef, lui qui est toujours dans la position haute, car alors, précisément, le retournement des asymétries serait bloqué. En fait, ce munus gubernandi, cette fonction de gouvernement, c’est l’art de faciliter la circulation du don de Dieu, c’est l’art d’aider à reconnaître là où Dieu parle à la communauté, et il y a toutes les chances que Dieu parle aussi – et même d’abord – par ceux qui paraissent les moins qualifiés pour cela.
A travers le témoignage de Nelly, on perçoit aussi l’importance de la prise en compte des autres positions que celles élaborées dans des lieux d’Eglise. Ce n’est pas toujours confortable, mais cela me semble important pour que l’Eglise ne parle pas que pour elle-même. Et dans ce mouvement d’écoute plus large que nos frontières, est à l’œuvre aussi ce renversement des asymétries ; car écouter, si on ne fait pas semblant, c’est accepter que l’autre soit en position d’autorité par rapport à moi. L’Eglise, qui a des choses à dire au monde, les dira d’autant mieux qu’elle aura vraiment écouté ce que disent les différents acteurs. Ce qui veut dire que nous nous mettons, à un moment donné, à l’école d’autres manières de voir et de penser que les nôtres.
Voilà donc le point sur lequel je voulais insister : l’Eglise est organisée comme un corps, et tout le monde n’y tient pas les mêmes fonctions, Paul le rappelle dans sa 1ère lettre aux Corinthiens. Mais il insiste sur les relations entre les membres de ce corps ; pour que relations il y ait, il faut que le courant passe dans les deux sens, que l’écoute, notamment, soit réversible. Ce n’est pas facile, parce que cela va passer par un retournement des positions établies. Mais il me semble que si l’on devait caractériser une sociabilité ecclésiale, il faudrait souligner ce trait : dans l’Eglise, les positions établies sont toujours prises à revers, comme pour indiquer qu’il ne s’agit que de positions transitoires au service de la relation vivante de Dieu avec son peuple.
Etienne Grieu
Facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres)
Pandémie, vie de l’Eglise, quelles leçons ? – Cardinal Mario Grech
CARDINAL MARIO GRECH : UNE INTERVIEW AVEC LE NOUVEAU SECRETAIRE DU SYNODE DES EVEQUES
Interview d’Antonio Spadaro sj et de Simone Sereni publié le 23 Octobre 2020.
L’interview a été publiée sur le site de la Civilta Catholica.
Nous reproduisons ci-dessous, avec leur accord, une traduction en français.
PANDEMIE, VIE DE L’EGLISE, QUELLES LEÇONS ?
 Mgr Mario Grech est le nouveau secrétaire général du Synode des évêques. Né à Malte en 1957, il a été nommé évêque de Gozo en 2005 par Benoît XVI. De 2013 à 2016, il a été président de la Conférence épiscopale de Malte. Le 2 octobre 2019, le pape François l’a nommé Pro-Secrétaire Général du Synode des évêques. À ce titre, il a participé au Synode sur l’Amazonie. L’expérience pastorale de Mgr Grech est vaste.
Mgr Mario Grech est le nouveau secrétaire général du Synode des évêques. Né à Malte en 1957, il a été nommé évêque de Gozo en 2005 par Benoît XVI. De 2013 à 2016, il a été président de la Conférence épiscopale de Malte. Le 2 octobre 2019, le pape François l’a nommé Pro-Secrétaire Général du Synode des évêques. À ce titre, il a participé au Synode sur l’Amazonie. L’expérience pastorale de Mgr Grech est vaste.
Sa gentillesse et sa capacité à écouter les questions nous ont incités à avoir une conversation libre. En partant de la situation de l’Église en période de pandémie – d’une ecclésiologie « en confinement » – et des défis importants qu’elle révèle pour aujourd’hui, nous sommes naturellement passés à des réflexions sur les sacrements, l’évangélisation, le sens de la fraternité humaine, et donc de la synodalité, que Monseigneur Grech considère comme étroitement liée. Une partie de l’entretien étant consacrée à la « petite église domestique », nous avons fait le choix d’une conversation menée conjointement par un prêtre et un laïc, marié et père de famille.
Mgr Grech, la période de pandémie que nous traversons encore, a forcé le monde entier à s’arrêter. La maison est devenue un lieu de refuge contre la contagion ; les rues se sont vidées. L’Église a été touchée par cette suspension de toute activité et les célébrations liturgiques publiques n’ont plus été autorisées. Quelles a été votre réflexion en tant qu’évêque, en tant que pasteur ?
Si nous prenons cela comme une opportunité, cela peut devenir un moment de renouveau. La pandémie a mis en lumière une certaine ignorance religieuse, une pauvreté spirituelle. Certains ont insisté sur la liberté de culte ou la liberté pour le culte, mais peu de choses ont été dites sur la liberté dans la manière de prier. Nous avons oublié la richesse et la variété des expériences qui nous aident à contempler le visage du Christ. Certains ont même dit que la vie de l’Église avait été interrompue ! Et c’est vraiment incroyable. Dans la situation qui a empêché la célébration des sacrements, nous n’avons pas réalisé qu’il y avait d’autres manières de faire l’expérience de Dieu.
Dans l’Évangile de Jean, Jésus dit à la Samaritaine : « L’heure vient où vous n’adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. […] L’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père recherche » (Jean 4,21-23). La fidélité du disciple à Jésus ne peut être compromise par l’absence temporaire de liturgie et de sacrements. Le fait que de nombreux prêtres et laïcs soient entrés en crise parce que tout à coup nous nous sommes retrouvés dans la situation de ne pas pouvoir célébrer l’Eucharistie coram populo est en soi très significatif. Pendant la pandémie, un certain cléricalisme est apparu, même via les réseaux sociaux. Nous avons été témoins d’un degré d’exhibitionnisme et de piétisme qui a plus à voir avec la magie qu’avec une expression de foi mature.
Alors quel défi pour aujourd’hui ?
Lorsque le temple de Jérusalem où Jésus a prié a été détruit, les Juifs et les Gentils, n’ayant pas de temple, se sont rassemblés autour de la table familiale et ont offert des sacrifices par leurs lèvres et par des prières de louange. Lorsqu’ils ne pouvaient plus suivre la tradition, les Juifs et les Chrétiens ont repris la loi et les prophètes et les ont réinterprétés d’une nouvelle manière. [1] C’est aussi le défi pour aujourd’hui.
Lorsqu’il a écrit sur la réforme dont l’Église avait besoin, Yves Congar a affirmé que la « mise à jour » souhaitée par le Concile devait aller jusqu’à la découverte d’une manière nouvelle d’être, de parler et de s’engager qui réponde au besoin d’un service évangélique total pour le monde. Au lieu de cela, de nombreuses initiatives pastorales de cette période ont été centrées sur la seule figure du prêtre. L’Église, en ce sens, semble trop cléricale et le ministère est contrôlé par des clercs. Même les laïcs sont souvent conditionnés par un modèle de cléricalisme fort.
Le confinement que nous avons vécu, nous oblige à ouvrir les yeux sur la réalité que nous vivons dans nos églises. Il faut réfléchir, s’interroger sur la richesse des ministères laïcs dans l’Église, comprendre si, et comment ils se sont exprimés. A quoi sert une profession de foi, si cette même foi ne devient pas le levain qui transforme la pâte de la vie ?
Quels aspects de la vie de l’Église ont émergé de cette période contrastée ?
Nous avons découvert une nouvelle ecclésiologie, peut-être même une nouvelle théologie, et un nouveau ministère. Cela indique donc qu’il est temps de faire les choix nécessaires pour s’appuyer sur ce nouveau modèle de ministère. Ce serait un suicide si, après la pandémie, nous revenions aux mêmes modèles pastoraux que ceux que nous avons pratiqués jusqu’à présent. Nous dépensons une énergie énorme à essayer de convertir la société sécularisée, mais il est plus important de nous convertir nous-mêmes pour réaliser la conversion pastorale dont le pape François parle souvent.
Je trouve curieux que beaucoup de gens se soient plaints de ne pas pouvoir recevoir la communion et célébrer les funérailles à l’église, mais bien moins se sont inquiétés de savoir comment se réconcilier avec Dieu et son prochain, comment écouter et célébrer la Parole de Dieu et comment vivre une vie de service.
En ce qui concerne la Parole, nous devons donc espérer que cette crise, dont les effets nous accompagneront pendant longtemps, sera pour nous, en tant qu’Église, un moment opportun pour remettre l’Évangile au centre de notre vie et de notre ministère. Beaucoup sont encore « analphabètes de l’Évangile ».
À cet égard, vous avez déjà évoqué la question de la « pauvreté spirituelle » : quelle est sa nature et quelles sont, à votre avis, les causes les plus évidentes de cette pauvreté ?
Il est indéniable que l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne ou, comme d’autres préfèrent le dire, le sommet et la source de la vie même de l’Église et des fidèles [2] ; et il est également vrai que « la célébration liturgique […] est l’action sacrée par excellence, et qu’aucune autre action de l’Église n’égale son efficacité au même degré » [3] ; mais l’Eucharistie n’est pas la seule possibilité pour le chrétien d’expérimenter le Mystère et de rencontrer le Seigneur Jésus. Paul VI l’a bien observé en écrivant que dans l’Eucharistie « la présence du Christ est « réelle » et non de façon exclusive, comme si les autres n’étaient pas « réelles ». » [4]
Par conséquent, il est préoccupant que quelqu’un se sente perdu en dehors du contexte eucharistique ou du culte, car cela montre une ignorance des autres façons de s’engager dans le Mystère. Cela indique non seulement qu’il existe un certain « analphabétisme spirituel », mais c’est la preuve de l’insuffisance de la pratique pastorale actuelle. Il est très probable que dans un passé récent, notre activité pastorale a cherché à conduire aux sacrements et non à conduire – à travers les sacrements – à la vie chrétienne.
La pauvreté spirituelle et l’absence d’une vraie rencontre avec l’Évangile ont de nombreuses implications…
Certainement. Et on ne peut pas vraiment rencontrer Jésus sans s’engager à l’égard de sa Parole. Concernant le service, voici une réflexion : ces médecins et infirmières qui ont risqué leur vie pour rester proches des malades n’ont-ils pas transformé les salles d’hôpital en « cathédrales » ? Le service aux autres dans leur travail quotidien, en proie aux exigences de l’urgence sanitaire, était pour les chrétiens un moyen efficace d’exprimer leur foi, de refléter une Église présente dans le monde d’aujourd’hui, et non plus une « Église de sacristie », absente des rues, ou se satisfaisant de projeter la sacristie dans la rue.
Ainsi, ce service peut-il être un moyen d’évangélisation ?
La fraction du pain eucharistique et de la Parole ne peut se faire sans rompre le pain avec ceux qui n’en ont pas. C’est cela la diaconie. Les pauvres sont théologiquement le visage du Christ. Sans les pauvres, on perd le contact avec la réalité. Ainsi, tout comme un lieu de prière dans la paroisse est nécessaire, la présence de la cuisine pour la soupe, au sens large du terme, est importante. La diaconie ou le service d’évangélisation là où il y a des besoins sociaux est une dimension constitutive de l’être de l’Église, de sa mission.
De même que l’Église est missionnaire par nature, c’est de cette nature missionnaire que découle la charité pour notre prochain, la compassion, qui est capable de comprendre, d’aider et de promouvoir les autres. La meilleure façon de faire l’expérience de l’amour chrétien est le ministère du service. Beaucoup de gens sont attirés par l’Église non pas parce qu’ils ont participé à des cours de catéchisme, mais parce qu’ils ont participé à une expérience significative de service. Et cette voie d’évangélisation est fondamentale dans l’ère actuelle de changement, comme le Saint-Père l’a observé dans son discours à la Curie en 2019 : « Nous ne sommes plus en régime de chrétienté. »
La foi, en fait, n’est plus une condition préalable évidente pour vivre ensemble. Le manque de foi, ou plus clairement la mort de Dieu, est une autre forme de pandémie qui fait mourir des gens. Je me souviens de la déclaration paradoxale de Dostoïevski dans sa Lettre à Fonvizin : « Si quelqu’un me montrait que le Christ est en dehors de la vérité et qu’il s’avère effectivement que la vérité est en dehors du Christ, je préférerais rester avec le Christ plutôt qu’avec la vérité. ” Le service rend manifeste la vérité propre au Christ.
La fraction du pain à la maison pendant le confinement a finalement mis en lumière la vie eucharistique et ecclésiale vécue dans la vie quotidienne de nombreuses familles. Pouvons-nous dire que le foyer est redevenu Église, y compris « église » au sens liturgique ?
Cela m’a semblé très clair. Et ceux qui, pendant cette période où la famille n’a pas eu l’opportunité de participer à l’Eucharistie, n’ont pas saisi l’occasion d’aider les familles à développer leur propre potentiel, ont raté une occasion en or. D’un autre côté, il y a eu des familles qui, en cette période de restrictions, se sont révélées, de leur propre initiative, « créatives dans l’amour ». Cela inclut la manière dont les parents accompagnent leurs jeunes dans des formes de scolarisation à domicile, l’aide offerte aux personnes âgées, la lutte contre la solitude, la création d’espaces de prière et la disponibilité aux plus pauvres. Que la grâce du Seigneur multiplie ces beaux exemples et redécouvre la beauté de la vocation et des charismes cachés dans toutes les familles.
Vous avez parlé plus tôt d’une « nouvelle ecclésiologie » qui émerge de l’expérience forcée du confinement. Que suggère cette redécouverte de la maison ?
Cela suggère que l’avenir de l’Église est ici, à savoir, dans la réhabilitation de l’Église domestique et en lui donnant plus d’espace, une Église-famille composée d’un certain nombre de familles-Église. Telle est la prémisse valide de la nouvelle évangélisation, qui nous semble si nécessaire entre nous. Nous devons vivre l’Église au sein de nos familles. Il n’y a pas de comparaison entre l’Église institutionnelle et l’Église domestique. La grande Église communautaire est composée de petites Églises qui se rassemblent dans des maisons. Si l’Église domestique échoue, l’Église ne peut pas exister. S’il n’y a pas d’Église domestique, l’Église n’a pas d’avenir ! L’Église domestique est la clé qui ouvre des horizons d’espérance !
Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons une description détaillée de l’Église domestique, la domus ecclesiae : « Jour après jour, alors qu’ils passaient beaucoup de temps ensemble dans le temple, ils rompaient le pain à la maison et mangeaient leur nourriture avec un cœur heureux et généreux » (Actes 2,46). Dans l’Ancien Testament, la maison familiale était le lieu où Dieu se révélait et où la célébration la plus solennelle de la foi juive, la Pâque, était célébrée. Dans le Nouveau Testament, l’Incarnation a eu lieu dans une maison, le Magnificat et le Benedictus ont été chantés dans une maison, la première Eucharistie a eu lieu dans une maison, de même que l’envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Au cours des deux premiers siècles, l’Église se réunissait toujours dans la maison familiale.
Récemment, l’expression « petite église domestique » a souvent été utilisée avec une note réductrice, peut-être involontairement… Cette expression aurait-elle pu contribuer à affaiblir la dimension ecclésiale du foyer et de la famille, si facilement comprise par tous, et qui nous paraît aujourd’hui si évidente ?
Nous en sommes peut-être à ce stade à cause du cléricalisme, qui est l’une des perversions de la vie sacerdotale et de l’Église, malgré le fait que le Concile Vatican II ait restauré la notion de famille comme « Église domestique » [5] en développant l’enseignement sur le sacerdoce commun. [6] Dernièrement, j’ai lu cette explication précise dans un article sur la famille. La théologie et la valeur de la pastorale dans la famille vue comme Église domestique ont pris un tournant négatif au IVe siècle, avec la sacralisation des prêtres et des évêques, au détriment du sacerdoce commun du baptême, qui commençait à perdre de sa valeur. Plus l’institutionnalisation de l’Église progressait, plus la nature et le charisme de la famille en tant qu’Église domestique diminuait. Ce n’est pas la famille qui est subsidiaire à l’Église, mais c’est l’Église qui doit être subsidiaire à la famille. Dans la mesure où la famille est la structure fondamentale et permanente de l’Église, il convient de lui redonner une dimension sacrée et cultuelle, la domus ecclesiae. Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome enseignent, dans le sillage du judaïsme, que la famille doit être un milieu où la foi peut être célébrée, méditée et vécue. Il est du devoir de la communauté paroissiale d’aider la famille à être une école de catéchèse et un espace liturgique où le pain peut être rompu sur la table de la cuisine.
Qui sont les ministres de cette « Église-famille » ?
Pour saint Paul VI, le sacerdoce commun est vécu de manière éminente par les époux, armés de la grâce du sacrement du mariage [7]. Les parents, donc, en vertu de ce sacrement, sont aussi les « ministres du culte », qui, pendant la liturgie domestique rompent le pain de la Parole, prient avec elle et transmettent la foi à leurs enfants. Le travail des catéchistes est valable, mais il ne peut remplacer le ministère de la famille. La liturgie familiale elle-même initie les membres à participer plus activement et consciemment à la liturgie de la communauté paroissiale. Tout cela permet de faire la transition de la liturgie avec un clerc à la liturgie familiale.*
Au-delà de l’espace strictement domestique, croyez-vous que la spécificité de ce « ministère » de la famille, des époux et de la relation conjugale peut et doit aussi avoir une importance prophétique et missionnaire pour toute l’Église ainsi que pour le monde ? Sous quelles formes, par exemple ?
Bien que pendant des décennies, l’Église ait réaffirmé que la famille est la source de l’action pastorale, je crains qu’à bien des égards, cela ne soit maintenant devenu simplement une partie de la rhétorique de la pastorale familiale. Beaucoup ne sont toujours pas convaincus du charisme évangélisateur de la famille ; ils ne croient pas que la famille a une « créativité missionnaire ». Il y a beaucoup à découvrir et à intégrer. J’ai personnellement vécu une expérience très stimulante dans mon diocèse avec la participation des couples et des familles à la pastorale familiale. Certains couples ont participé à la préparation du mariage ; d’autres accompagnaient les jeunes mariés au cours des cinq premières années de leur mariage (8).
Les familles « sont appelées à poser leur marque dans la société, trouvant d’autres expressions de fécondité qui prolongent en quelque sorte l’amour qui les soutient. » [9] Un résumé de tout cela se trouve dans le Document final du Synode des Évêques sur le Famille, où les Pères synodaux écrivaient : « La famille se constitue ainsi comme sujet de l’action pastorale à travers l’annonce explicite de l’Évangile et l’héritage de multiples formes de témoignage : solidarité avec les pauvres, ouverture à la diversité des personnes, soin de la création, solidarité morale et matérielle avec les autres familles, en particulier les plus nécessiteuses, engagement pour la promotion du bien commun à travers la transformation de structures sociales injustes, à partir du territoire dans lequel il vit, en pratiquant des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. » [10]
Revenons maintenant à considérer un horizon plus large. Le virus ne connaît pas de barrières. Si des égoïsmes individuels et nationaux sont apparus, il est vrai qu’il est clair aujourd’hui que sur Terre nous vivons une fraternité humaine fondamentale.
Cette pandémie doit nous conduire à une nouvelle compréhension de la société contemporaine et nous permettre de discerner une nouvelle vision de l’Église. On dit que l’histoire est un professeur qui n’a souvent pas d’élèves ! Précisément à cause de notre égoïsme et de notre individualisme, nous avons une mémoire sélective. Non seulement nous effaçons de notre mémoire les difficultés que nous causons, mais nous sommes également capables d’oublier nos voisins. Par exemple, dans cette pandémie, les considérations économiques et financières ont souvent pris le pas sur le bien commun. Dans nos pays occidentaux, bien que nous soyons fiers de vivre en régime démocratique, en pratique tout est conduit par ceux qui possèdent le pouvoir politique ou économique. Au lieu de cela, nous devons redécouvrir la fraternité. Si l’on assume la responsabilité liée au Synode des Évêques, je pense que synodalité et fraternité sont deux termes qui se s’appellent mutuellement.
Dans quel sens ? La synodalité est-elle également proposée à la société civile ?
Une caractéristique essentielle du processus synodal dans l’Église est le dialogue fraternel. Dans son discours au début du Synode sur les jeunes, le Pape François a déclaré : « Le Synode doit être un exercice de dialogue avant tout entre ceux d’entre vous qui y participent. » [11] Et le premier fruit de ce dialogue est que chacun s’ouvre à la nouveauté, au changement d’opinion, à se réjouir de ce que disent les autres. » [12] Par ailleurs, au début de l’Assemblée spéciale du Synode pour l’Amazonie, le Saint-Père a fait référence à la « fraternité mystique » [13] et a souligné l’importance d’une atmosphère fraternelle parmi les pères synodaux, « en gardant la fraternité qui doit exister ici » [14] et non la confrontation. À une époque comme la nôtre, où l’on assiste à des revendications excessives de souveraineté des États et à un retour d’une approche de classes, les sujets sociaux pourraient réévaluer cette approche « synodale », ce qui faciliterait une voie de rapprochement et une vision coopérative. Comme le soutient Christoph Theobald, ce « dialogue fraternel » peut ouvrir une voie pour surmonter la « lutte entre intérêts compétitifs » : «Seul un sentiment réel et quasi-physique de « fraternité » peut permettre de surmonter la lutte sociale et de donner accès à une compréhension et une cohésion, certes fragiles et temporaires. L’autorité se transforme ici en « autorité de fraternité » ; une transformation qui suppose une autorité fraternelle, capable de susciter, par interaction, le sentiment évangélique de fraternité – ou “ l’esprit de fraternité ”, selon le premier article de la Déclaration universelle des droits de l’homme – alors que les tempêtes de l’histoire risquent de le balayer. » [15]
Dans ce cadre social, les paroles clairvoyantes du Saint-Père résonnent fortement lorsqu’il a dit qu’une Église synodale est comme une bannière levée parmi les nations dans un monde qui appelle à la participation, à la solidarité et à la transparence dans l’administration des affaires publiques, mais qui au contraire place souvent le sort de tant de gens entre les mains avides de groupes au pouvoir étroit. Dans le cadre d’une Église synodale qui « marche ensemble » avec les hommes et les femmes et participe aux travaux de l’histoire, nous devons cultiver le rêve de redécouvrir la dignité inviolable des peuples et la fonction de service de l’autorité. Cela nous aidera à vivre d’une manière plus fraternelle et à construire un monde, pour ceux qui viendront après nous, qui soit plus beau et plus digne de l’humanité. [16]
Notes et références :
- DOI: La Civiltà Cattolica, En. Ed. Vol. 4, no. 10 art. 7, 1020: 10.32009/22072446.1020.7
- [1]. See T. Halik, “Questo è il momento per prendere il largo”, in Avvenire, April 5, 2020, 28.
- [2]. See Vatican Ecumenical Council II, Constitution Sacrosanctum Concilium (SC), No. 10, December 4, 1963.
- [3]. SC 7.
- [4]. Paul VI, Encyclical Letter Mysterium Fidei, No. 40, September 3, 1965.
- [5]. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution Lumen Gentium (LG), No. 11; Decree Apostolicam Actuositatem (AA), No. 11.
- [6]. See LG 10.
- [7]. Paul VI, General Audience, August 11, 1976.
- [8]. Francis, General Audience, September 16, 2015.
- [9]. Id., Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris laetitia, No. 181, March 19, 2016.
- [10]. Final Report of the Synod of Bishops, October 24, 2015.
- [11]. Francis, Address at the beginning of the Synod dedicated to young people, October 3, 2018.
- [12]. See ibid.
- [13]. Id., Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, No. 92, November 24, 2013.
- [14]. Id., Greeting at the opening of the Special Assembly of the Synod of Bishops for the Pan-Amazonian Region, October 7, 2019.
- [15]. C. Theobald, Dialogue and Authority between Society and Church, prolusion at the Dies academicus of the Theological Faculty of Triveneto (www.fttr.it/wp-content/uploads/2018/11/THEOBALD-prolusione-dies-Fttr22-11-2018.pdf), November 22, 2018. https://www.laciviltacattolica.com Interview de Mgr Mario GRECH – 23 Octobre 2020
- [16]. Cf. Francis, Address for the 50th Anniversary of the Institution of the Synod of Bishops, October 17, 2015.
Un moment de vérité
Véronique Margron (avec Jérôme Cordelier), Un moment de vérité, Albin Michel, 2019, 190 pages, 18 €.
Sœur Véronique Margron et devenue l’une des grandes voix de l’Église de France. Son expérience auprès de la protection de l’enfance l’a rendue sensible à la pédocriminalité, particulièrement celle qui est du fait de clercs. Dans ce livre, on retrouvera bien des thèmes déjà contenus dans l’entretien qu’elle a donné à Études en décembre 2018. Il faut d’abord prendre la mesure de ce qui nous arrive en mettant des mots sur les scandales. La dimension de « sacré » accentue la gravité du crime dans la mesure où « la référence à Dieu est un tragique facilitateur d’emprise ». On découvre alors que ces affaires peuvent être l’occasion d’un renouveau spirituel, celle de revenir à des pratiques plus évangéliques. Mais cela suppose un travail de réflexion qui n’hésite pas à aller en profondeur. Plusieurs pages sont consacrées à la question délicate de la sexualité. Pour accéder à l’éthique, il vaut mieux sortir du registre du pur et de l’impur. On s’arrêtera particulièrement sur les « douze travaux » proposés en fin d’ouvrage. Parmi ceux, on peut retenir : la mise au centre des victimes, la désacralisation de la figure du prêtre, la promotion de la place des femmes, le changement du style de l’Église, le renforcement du dialogue avec la société. Revoir le « style » consiste à sortir de toute posture de surplomb au profit du service de l’humain en sa vulnérabilité.
François Euvé
L’Église face aux abus sexuels sur mineurs
Marie-Jo Thiel, Bayard, 2019, 714 p.
Marie-Jo Thiel est médecin et professeure de théologie morale à Strasbourg. C’est aussi, en France, une connaisseuse avertie du dossier de la pédocriminalité dans l’Église catholique, puisqu’il y a plus de vingt ans qu’elle réfléchit, alerte et informe sur le sujet. Mobilisée dans les années 1990 par ses premières rencontres avec des personnes victimes de ces abus, elle a proposé dès 1998 aux évêques de France un article sur le sujet, avant de leur décrire, à Lourdes en 2000, la gravité du traumatisme subi et le clivage profond qui caractérise la personnalité des abuseurs pervers, fussent-ils prêtres de l’Église catholique.
Vingt ans plus tard donc, on s’aperçoit que ces premières prises de conscience et les mesures prises alors dans l’Église n’étaient pas suffisantes, ni pour protéger les enfants et les personnes vulnérables, ni pour rendre justice aux « survivants » – selon la terminologie anglo-saxonne qui préfère ce terme à celui de « victime ». La crise a pris l’ampleur que l’on sait et, avec elle, l’incompréhension, la colère et aussi beaucoup de confusion dans les esprits, en particulier dès qu’il s’agit d’essayer d’identifier les causes complexes de ce drame et de proposer des pistes de prévention. Comment s’en étonner d’ailleurs, puisqu’il s’agit ici de sexualité agie sur des enfants et que la confusion est précisément l’une des grandes caractéristiques de ce type d’abus ?
Il faut donc savoir gré à Marie-Jo Thiel de nous aider, une fois encore, à mettre quelque clarté et précision dans ce dossier. Tout au long de cette vaste somme, elle explore très méthodiquement chacun des différents registres de la question – les faits, l’histoire, le droit civil et canonique, les éléments psychologiques, sociologiques et aussi ecclésiologiques. Elle nous partage chemin faisant l’importante documentation qu’elle a accumulée[1] – bibliographie, chiffres et enquêtes, prises de positions officielles, liens téléchargeables, etc. – et nous offre ainsi l’ouvrage de référence qui manquait.
L’autre grand intérêt de l’ouvrage est que Marie-Jo Thiel est une théologienne engagée, qui ne fait pas mystère de ses convictions. Elle prend ainsi vigoureusement position dans l’ensemble des débats et soubresauts qui accompagnent cette crise, en particulier quand elle essaie de comprendre les éléments canoniques et les présupposés théologiques et ecclésiologiques qui ont pu, non pas « créer » les passages à l’acte des abuseurs, mais les faciliter ou favoriser leur enfouissement dans le silence. À celles et ceux qui estiment que l’Église ne serait pas plus coupable que d’autres institutions et qu’elle est même, en cette affaire, surtout victime d’un acharnement médiatique, elle rappelle ainsi que céder à cette « pulsion victimaire », c’est très précisément inverser les rôles avec les réelles victimes, comme savent justement si bien le faire les sujets pervers ; c’est surtout risquer de s’enfermer encore un peu plus dans son propre système.
Car « système » il y a, pour l’auteure : elle martèle tout au long de ces pages que ces abus relèvent bien d’un vrai problème « systémique » et non pas seulement de l’égarement de quelques hommes pécheurs, comme il y en a toujours eu et aura toujours dans l’Église, ni de la mauvaise formation ou information des évêques, à un moment de l’Histoire où la société tout entière mesurait mal la gravité de la pédocriminalité. Elle décrit donc ce système où culture du secret, théologie du ministère ordonné (qui lie indissolublement célibat, masculinité et présidence de l’assemblée), morale sexuelle et familiale fondée sur un « universel normatif intransigeant », aboutissent, quelles que soient les intentions de départ, à sacraliser la figure du prêtre, à exclure de tous les vrais lieux de décision laïcs et femmes, à construire un gouvernement d’hommes qui ne peut être remis en question de l’extérieur et risque de chercher à protéger les siens plutôt que les petits. Impossible donc, dans la lutte contre les abus sexuels, d’évoquer des causes univoques et simplistes (le célibat des prêtres pour certains, l’homosexualité ou le laxisme sexuel de la société pour d’autres). Impossible aussi de se contenter d’agir sur l’accueil des « survivants », sur la clarification du droit canon et des procédures de signalement, sur l’établissement de « guide lines », sur la formation : tout cela est bien évidemment nécessaire et même urgent, mais ce serait comme mettre un « pansement sur un tissu nécrosé », si l’on ne travaillait pas en même temps à un nouveau style d’Église.
Par bien des aspects, on le voit, Marie-Jo Thiel rejoint le diagnostic du pape François quand il dénonce le « cléricalisme ». Attention, dit-elle cependant avec quelque humour inquiet devant certaines déclarations d’évêques, à ne pas faire de ce mot un « mot-valise » à la « fonction cathartique » qui, en posant le cléricalisme comme une simple tentation commune à tous, éviterait précisément de s’attaquer aux racines du mal : comme si les laïcs et, parmi eux, les femmes, qui n’ont guère eu jusqu’ici accès aux décisions ni au simple « agenda » des questions à traiter dans l’Église, portaient le même degré de responsabilité dans cette crise. En tout cas, voici la parole d’une théologienne qui n’a pas peur de répondre à l’appel fait par le pape François à tout le peuple de Dieu, ni de prendre courageusement sa part de responsabilité dans la crise actuelle.
Emmanuelle Maupomé
[1] Au moins jusqu’en janvier 2019, c’est-à-dire avant le dernier sommet romain avec les présidents des conférences épiscopales, la sortie en France du documentaire d’Arte sur les abus commis sur les religieuses, du film de François Ozon Grâce à Dieu, du livre Sodoma (Robert Laffont, 2019), le motu proprio Vos estis lux Christi… Une éternité !
On savait, mais quoi ?
On savait, mais quoi ? La pédophilie dans l’Église de la Révolution à nos jours
Claude Langlois, Editions Seuil, 2020, 240 p.
On entend souvent, au sujet des délits sexuels dont les révélations se multiplient, que les évêques « savaient »… L’Église savait donc, mais quoi exactement, et depuis quand ? Pour y répondre en historien, Claude Langlois s’intéresse à la manière dont l’Église a cherché à gérer ses clercs en difficulté et les prêtres pédophiles en particulier. L’Église savait bien, tout comme l’opinion publique d’ailleurs, la réalité de comportements sexuels graves, y compris sur des mineurs, de la part de prêtres ou de frères enseignants. Ces comportements ont été au fil du temps diversement interprétés (péché, inaptitude au sacerdoce, maladie mentale, délit ou crime) et traités (interdiction du ministère, soin ou, le plus souvent, simple déplacement du prêtre et soutien pour lui permettre d’échapper aux poursuites judiciaires). On savait donc des prêtres coupables, mais on ne savait guère, malgré les alertes lucides de certains, ni le danger que représentaient ces prêtres simplement déplacés, ni surtout la dévastation produite par leur crime sur les enfants victimes. Car l’histoire de la pédophilie dans l’Église est celle de la préoccupation pour les prêtres coupables bien plus que celle de l’attention aux victimes, dont la parole, portée d’abord par la société civile, n’a pu se faire entendre que très récemment. Si l’auteur annonce ne pas avoir l’ambition d’apporter « la ferme certitude des causes, ni les remèdes », il offre pourtant une enquête rigoureuse et qui se lit d’un trait. Plus encore, il partage en conclusion des convictions très suggestives, notamment ceci : les réflexions nées de cette crise portent aujourd’hui plus souvent sur les abus et leur gestion – abus de pouvoir, abus sexuels – que sur la nécessité de repenser fondamentalement les rapports du pouvoir et de la sexualité dans l’Église catholique.
Emmanuelle Maupomé
Scandales dans l’Église, des théologiens s’engagent
Catehrine Fino, Préface de Véronique de Thuy-Croizé, Cerf, 2020, 160 p.
Fruit d’un travail collectif et interdisciplinaire, réalisé à la demande de la Conférence des évêques de France, cet ouvrage représente la « première étape » d’une réflexion qui est ici soumise au « débat ». Il interroge la « responsabilité propre de la théologie » dans la crise des abus que traverse aujourd’hui l’Église et revêt donc une grande actualité. L’ouvrage croise perspectives spirituelle, morale, ecclésiologique et liturgique. Gilles Berceville met en lumière le fait que, dans les abus, c’est la foi elle-même qui est manipulée et suggère que cette manipulation possède des caractéristiques distinctes en contexte catholique. La riche contribution de Catherine Fino provoque à penser une juste intégration de la « vulnérabilité » en théologie. Luc Forestier, questionnant une conception verticale de l’autorité, invite à prendre acte tant du tournant synodal réalisé par le pape François, que du « poids des facteurs politiques » justifiant une prise en compte de « la situation de nos démocraties incertaines ». Dans cette ligne, Gilles Drouin incite à approfondir l’articulation entre sacerdoce baptismal et « ministère sacerdotal qui n’a de sens que pour permettre l’expression ou l’épanouissement du sacerdoce baptismal ». Enfin, Éric Vinçon propose des pistes pour une meilleure formation et pour un meilleur accompagnement des prêtres, encourageant notamment à développer une « culture de la supervision ». L’on ne peut que souhaiter que cet ouvrage suscite un authentique débat, stimulant une réflexion théologique si urgente.
Agnès Desmazières