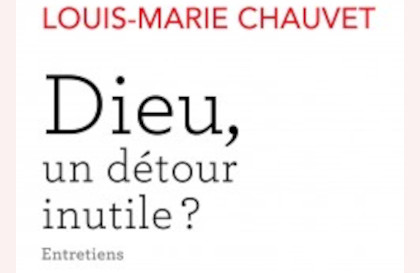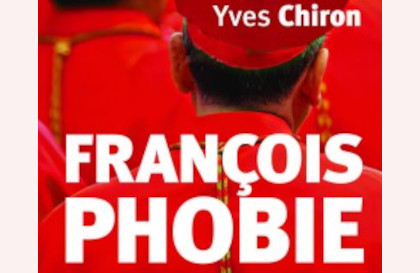La formation des prêtres
Nathalie Becquart répond au questionnaire de promesses d’Eglise
Nathalie Becquart est une religieuse xavière française. Responsable durant dix années de 2008 à 2018 du Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) au sein de la Conférence des évêques de France, elle est nommée le sous-secrétaire du synode des évêques.

Malgré un emploi du temps chargé, elle a nous a fait parvenir ce court entretien vidéo où elle répond à notre questionnaire.
Le chemin synodal allemand – Jérôme Vignon
Contrarié par la Covid 19, mais soutenu par l’enthousiasme des participant(e)s, le Chemin synodal allemand aborde une nouvelle phase1
Le contexte
L’Eglise catholique en Allemagne fut très profondément ébranlée par les scandales des agressions et crimes sexuels commis par des clercs à l’encontre d’enfants et d’adultes et ce dès le début des années 2000. Prenant le « taureau par les cornes », la Conférence des évêques alors présidée par le Cardinal Marx, archevêque de Munich, commanditait en 2013 un rapport d’experts indépendants dit rapport MGH destin à faire une lumière complète sur le sujet et à émettre des recommandations. Sur base de ce rapport finalement rendu public en juillet et tenant compte de l’émotion qu’il suscita , la Conférence des évêques en Allemagne a pris trois décisions majeures : l’instauration d’un dispositif complet de prévention , observation et réparation des agressions sexuelles dans l’Eglise ; la mise en place d’une juridiction administrative interne à l’église propre à sanctionner les manquements dans l’exercice de l’autorité ecclésiale ; le lancement d’un processus de réformes structurelles destiné à construire collectivement l’avenir de l’église allemande sous la forme d’une démarche originale désignée comme Chemin synodal , offrant aux laïcs allemands la possibilité d’un co-pilotage de cette démarche . Ce processus a été ratifié par les laïcs qui sont, en Allemagne, rassemblés de longue date au sein d’un vaste comité fédérateur et représentatif, le Zentral Kommittee der Deutschen Katholiken (ZDK). Le Chemin synodal a effectivement démarré en janvier 2020 et doit s’achever à la fin de 2022. Jérôme Vignon rapporte ici les fruits d’une réunion d’étape de ce Chemin synodal tenue en vision conférence les 4 et 5 février 2021, à laquelle il assistait en tant qu’observateur invité.
Qu’est-ce qu’un chemin synodal ?
Concrètement le Chemin synodal (CS) allemand est une assemblée constituée de 230 membres permanents à parité entre clercs et laïcs de l’église catholique d’Allemagne. Tous les évêques en sont membres d’office ; prêtres, diacres et membres des congrégations religieuses en font également partie aux titres des clercs, désignés par différents collèges assurant leur représentativité. De même les laïcs sont-ils en partie désignés par le Comité central des catholiques allemands (ZdK) et par d’autres organisations de laïcs qui n’en seraient pas membres. Au total, cette assemblée est bien représentative de la diversité des personnes qui se réclament activement de la foi catholique en Allemagne. Le paritarisme de l’organisation clercs et laïcs est assuré formellement par un pilotage conjoint entre la conférence des évêques d’un côté (DBK), le ZDK de l’autre. Ainsi chaque assemblée générale du Chemin est-elle Co présidée par un évêque et un laïc, de fait le plus souvent une laïque. L’assemblée générale du Chemin synodal a tenu sa première réunion plénière en janvier 2020 à Frankfort et devrait tenir l’assemblée de conclusion à la fin de 2022 avec entretemps deux réunions intermédiaires fin 2021 et au premier trimestre 2022.
L’irruption de la pandémie a contraint d’entrée de jeu à modifier le rythme prévu initialement et à organiser des rencontres régionales partielles (en septembre 2020) ainsi qu’une Visio conférence générale les 4 et 5 février derniers. Le caractère strict du règlement intérieur régissant les délibérations et la prise de décision ne fait qu’aucune de ces rencontres n’a eu un caractère décisionnel. En revanche, le temps a été mis à profit pour approfondir l’analyse et la confrontation des points de vue. La Visio conférence « plénière « des 4 et 5 février dont il sera ici rendu compte constitue de ce fait une étape importante : on peut dire qu’elle donne le départ à une étape d’élaboration de propositions qui seront ensuite raffinées au cours des deux années à venir. En ce sens, considérant la longueur du processus et les précautions prises pour assurer la transparence et l’équité des délibérations, on peut dire que l’on se trouve devant une sorte de pèlerinage ecclésial de longue haleine. C’est d’ailleurs au « peuple catholique pèlerin allemand « que le pape François a adressé en juillet 2019 la lettre publique par laquelle il donnait son aval à une démarche que certaines autorités « conservatrices « jugeaient prématurée, voire dangereuse.
La finalité profonde du Chemin synodal
On ne peut comprendre ce processus original du Chemin synodal allemand sans se souvenir de deux éléments de son initiation qu’on ne retrouve dans aucune église catholique ailleurs en Europe :
L’onde de choc des abus sexuels a été non seulement très fortement, mais aussi longuement ressentie par l’ensemble des « forces vives « de l’église en Allemagne. Une succession de rapports depuis le début des années 2000 ont souligné le caractère massif des abus ainsi que le silence qui pouvait les entourer, une dissimulation à laquelle la culture démocratique allemande est très sensible. Le choc a été ressenti d’autant plus durement que de nombreux catholiques exercent des fonctions rémunérées comme auxiliaires de la pastorale et de l’action sociale, en lien direct avec la hiérarchie catholique et s’estimaient de ce fait nolens volens associée à l’opprobre générale. Ce sentiment a été particulièrement vif lors de la publication en 2018 d’un rapport solide et complet2 qui ouvrait en même temps les quatre pistes des réformes structurelles qui constituent l’enjeu même du chemin synodal/.
-
La distribution des pouvoirs et des responsabilités dans l’Eglise.
-
L’existence des prêtres demain.
-
Place des femmes dans les services et les fonctions.
-
Réussir la vie relationnelle, l’amour dans le couple et la sexualité.
Ce sont les Evêques allemands, inquiets de l’ampleur du désaveu manifesté parmi les fidèles allemands qui ont proposé au ZdK en 2019 de rentrer dans ce processus original, conscients de ce qu’il fallait désormais frapper un grand coup en en proposant un dialogue structuré, sincèrement tourné vers la formulation et la mise en œuvre de réformes effectives. Un mot caractérise l’intention du chemin synodal : la crédibilité, une vertu cardinale dans la culture démocratique allemande. Le nouveau président de la DBK, Monseigneur Bätzing aura cette expression au début de la rencontre le 4 février 2021 : il s’agit pour nous à la fois de restaurer la crédibilité de l’Eglise et la plausibilité de la Foi. Ce raccourci souligne la finalité du Chemin synodal : restaurer la capacité missionnaire de l’église catholique en Allemagne.
L’enjeu de la Conférence en ligne des 4 et 5 février 2021
Structurée en assemblée plénière, en assemblées partielles par thèmes, éventuellement en ateliers par groupes d’une dizaine de participants, la Conférence en ligne des 4 et 5 février était le premier rendez-vous d’ensemble tenu depuis janvier 2020. Il s’agissait de prendre connaissance :
-
Des avancées de la mission confiée à Monseigneur Ackermann, évêque de Trèves, chargé par la DBK de coordonner les dispositions prises à l’échelle des diocèses pour la « clarification et réparation des abus sexuels ».
-
D’ouvrir une discussion sur des problématiques soulevées par les membres du CS et recueillir les réactions de l’AG virtuelle sur les rapports d’étape partiels élaborés par les quatre forums de l’Assemblée générale.
-
De procéder à des auditions autour des 4 rapports de progrès issus des forums thématiques afin de faire confirmer ou préciser la poursuite de leurs travaux en assemblée partielle.
Concrètement, les équipes « paritaires » clercs/laïcs en charge de la rédaction des rapports thématiques se trouvent en mesure d’avancer dans l’élaboration de propositions concrètes (futures résolutions de l’AG), nanties du soutien et des observations recueillies au cours de la Visio conférence. On s’attend donc à ce qu’en septembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent, une seconde Assemblée générale pourra commencer de délibérer sur des projets de résolution et les renvoyer pour approfondissement aux forums thématiques.
Ce que nous pourrions en retenir en tant que catholiques Français
Catholiques en France, nous sommes engagés selon une démarche qui nous est propre dans une approche synodale nationale : parce que nous répondons nous aussi à l’appel du Pape François dans le cadre de « Promesses d’Eglises », ou parce que nous nous inscrivons aux côtés des évêques Français dans la perspective d’un synode mondial consacré à la synodalité. La démarche allemande peut sinon nous inspirer au moins nous encourager à plusieurs titres.
C’est d’abord la preuve, administrée par l’Assemblée générale du chemin synodal, qu’une Eglise catholique nationale, riche d’une grande diversité de ministères et de missions peut se structurer en une assemblée représentative de cette diversité et s’organiser de manière à permettre que s’établisse un dialogue effectif entre toutes ses composantes. J’ai été témoin de la vivacité de ce dialogue lorsqu’il touche aux prérogatives de l’évêque, à la remise en cause de la doctrine en matière de relations amoureuses extra conjugales, à l’exclusivité du célibat sacerdotal, à l’accès des femmes aux responsabilités et aux ministères. Les conditions procédurales de fonctionnement du Chemin synodal sont telles que ce dialogue peut avoir lieu sans mettre en cause le principe d’une acceptation commune de la préservation de l’unité au nom d’une confiance accordée ensemble au travail de l’Esprit saint. Autrement dit, le risque pris d’afficher des désaccords n’a pas entamé le principe général de l’unité. C’est ce que relève la présidence du Chemin synodal dans les conclusions de la visio-conférence de février 2021 : « Il est d’autant plus important de rester ensemble dans la controverse et de ne pas abandonner la fraternité du Chemin, d’être l’Eglise ensemble. Donner des réponses franches alors que nous sommes à un tournant qui soulève des questions nouvelles et anciennes, au regard desquelles la confrontation est justifiée et nécessaire, signifie aussi ne pas toujours trouver des positions totalement unanimes. Mais il est important d’y aspirer, de chercher le cœur de la vérité dans le discours de quelqu’un dont je ne partage pas l’opinion «.
Les mêmes conditions procédurales permettent également de concilier l’égalité en dignité de tous les baptisés, clercs et laïcs, et la reconnaissance mutuelle de la différence des « sacerdoces », ministériels et baptismaux. Cette expérience était particulièrement sensible dans les assemblées partielles thématiques co- présidées par un évêque et un laïc (une laïque souvent). Dans ces assemblées, la présentation des rapports se fait à deux voix, rendant perceptible la complémentarité des points de vue. De même les échanges se déroulent ils sur le registre de la « co- construction » rendue possible par l’exposé organisé des points de vue et l’expression des répliques qu’ils suscitent.
C’est la mise en place, de façon lisible et transparente, d’un cadre commun à l’ensemble des diocèses pour l’instruction et la réparation des situations d’abus sexuels. J’ai pu constater combien ls interventions de Mgr Ackermann, chargé de la mise en place de ce cadre avec l’assistance d’un groupe d’experts catholiques et non catholiques et représentatifs de diverses disciplines des sciences sociales, avait un caractère apaisant pour l’assemblée du Chemin Synodal, tant clercs que laïcs. Une sorte de guidance de référence se met en place qui limite de fait les marges de manœuvre de chaque évêque, astreint à rendre publiques les conditions d’application du cadre général. C’est en s’appuyant sur ce cadre que le nouveau président de la Conférence des évêques -d’Allemagne a pu prendre une claire distance à l’égard du cafouillage catastrophique dont le cardinal de Cologne s’est rendu responsable en décidant de ne pas publier le rapport qu’il avait ordonné pour son diocèse, éteignant ainsi un incendie qui s’était déclaré quelques jours avant la tenue de la Visio conférence. Parmi les éléments du cadre commun figure l’instauration d’un comité des victimes dont les représentants ont été largement écoutés au cours de la conférence et qui devrait jouer un rôle permanent. La participation effective et les avis rendus par ce comité, sont aux dires de Karin Kortman, vice-présidente du ZdK et membre de la présidence du Chemin synodal, une condition majeure de la crédibilité de l’ensemble de la démarche.
On retiendra enfin les trois conditions de fonctionnement du Chemin synodal qui rendent possibles l’adoption de résolutions concrètes de réforme :
-
Il s’agit du cadre procédural qui garantit l’équité des processus aux yeux de toutes les parties prenantes.
-
La prégnance de l’accompagnement spirituel qui crée les conditions d’un discernement collectif : d’une certaine façon, les délibérations du CS sont en permanence resituées dans une logique de recherche de la volonté du Seigneur pour l’orientation de l’Eglise.
-
Cela tient aussi à la distinction claire établie au point de départ entre quatre niveaux de réformes potentielles : celui qui relèverait de l’évêque ; celui qui relèverait d’une décision prise à la majorité des membres de la Conférence des évêques allemands ; celui qui ressortirait de la seule autorité du Pape ; celui enfin qui relèverait d’un Concile. Dans ces derniers cas, les propositions de réforme seront transmises à Rome par le Chemin Synodal.
Le Chemin synodal allemand se situe d’entrée de jeu dans la perspective de l’Eglise universelle, la Weltkirche. C’est ce qui justifie la présence d’une vingtaine d’observateurs venus des églises catholiques voisines, mais aussi d’Afrique et d’Amérique latine. Ils sont présents en tant que témoins de l’Eglise universelle, disposent d’un temps de parole au cours des rencontres plénières et doivent évidemment rapporter ce qu’ils voient à leurs églises respectives.
A quoi pourraient ressembler les réformes portées par le Chemin synodal ?
Selon ma compréhension personnelle (que je n’ai pu confronter avec d’autres observateurs), c’est le premier forum consacré à « la distribution des pouvoirs et des responsabilités dans l’église « qui présente la forme la plus avancée. Il se présente en deux volets : le « Grundtext » qui fournit l’assise doctrinale et théologique de la réflexion et le « Handlungstext » qui contient les dispositions de réformes opérationnelles pour l’organisation des pouvoirs et des responsabilités. Ce 5 février, les caractéristiques d’ensemble du Grundtext ont reçu un large assentiment, notamment au chapitre des critères que devraient remplir les réformes opérationnelles. Sur ces bases, le « hearing » organisé en visio conférence a eu connaissance de trois exemples de projets de réforme présentés comme ayant un degré suffisant de maturité au regard de ces critères. Ils donnent une idée du type de changements auxquels pourraient se préparer les Catholiques allemands :
-
Instauration, à l’initiative de l’évêque, d’un « ordre de prédication », sorte de « réserve « de personnes habilitées à commenter les Ecritures lors des célébrations eucharistiques, où devraient figurer non seulement les clercs, mais aussi des laïcs, hommes et femmes, présentant les qualités requises.
-
Mise en place d’une cellule de médiation (Ombudsstelle) dans chaque diocèse, susceptible de recueillir et d’instruire (sans pouvoir décisionnaire) les différends résultant d’un exercice supposé abusif du pouvoir ecclésiastique.
-
Organisation s’un cadre comptable homogène pour la gestion des finances diocésaines susceptible de donner lieu à des audits indépendants.
Ce compte -rendu ne serait pas complet si l’on n’y mentionnait pas l’atmosphère joyeuse perceptible dans les ateliers3. Nombre de participants, singulièrement de participantes, éprouvent et donnent le sentiment de contribuer à une tâche de renouveau qui ouvre d’autant plus d’espoirs que la période qui s’est écoulée a pu provoquer de tristesse et de désillusion.
Jérôme Vignon
Observateur du Chemin Synodal invité par le ZdK
1 Résumé présenté par Jérôme Vignon en tant qu’observateur français auprès du Chemin synodal avec Monseigneur Berthet, évêque de Saint Dié et Epinal.
2 Rapport des experts MGH d’après les villes sièges des principaux instituts de recherche associés pour son élaboration : Mannheim, Giessen, Heidelberg.
3 Voir la liste jointe des thèmes d’ateliers proposés par les participants au CS les 4 et 5 février (Téléchargez le document en suivant ce lien )
Un temps pour changer – intervention de Monique Baujard à l’assemblée générale de Promesses d’Eglise
Intervention de Monique Baujard lors de l’assemblée générale de Promesses d’Eglise,
le 2 février 2021
Monique Baujard est doctorante en théologie et responsable associatif
Le collectif Promesses d’Eglise s’est formé à la suite de la Lettre au Peuple de Dieu du pape François. Une lettre qui marque un point de non-retour dans l’Eglise. D’abord parce que le pape y fait le lien entre abus sexuels, abus de pouvoir et abus de conscience. Ensuite, parce qu’il invite explicitement tous les baptisés à se préoccuper du fonctionnement interne de l’Eglise. Le pape lie très fortement transformation ecclésiale et sociale. L’Eglise n’existe pas pour elle-même, elle est là pour le monde. Pour éclairer le monde, elle doit sortir de la crise des abus, elle doit en sortir transformée.
C’est à partir de la crise, non pas des abus, mais de la Covid-19, que le pape a publié un petit livre intitulé « Un temps pour changer ». Paru début décembre 2020, il n’a pas bénéficié de beaucoup de publicité, peut-être parce qu’il est venu peu de temps après Fratelli tutti. Fratelli tutti est un très beau texte qui reprend beaucoup d’allocutions faites par le pape François sur le thème de la fraternité en différentes occasions. C’est aussi une encyclique, donc un document officiel et assez long du magistère.
Le livre « Un temps pour changer » offre un texte beaucoup plus court mais aussi une parole beaucoup plus personnelle du pape François. Il parle de la crise sanitaire qui nous déstabilise tous et se livre à une réflexion sur l’incidence des crises dans nos vies (1). Il affine un certain nombre de ses idées, déjà esquissées ailleurs. Sur deux points, sa pensée est originale et novatrice. D’abord lorsqu’il s’agit d’aborder les conflits et les divergences. Sur ce point le pape fait le lien avec la synodalité et cela rejoint très directement l’expérience de Promesses d’Eglise (2). Je n’aurai pas le temps ce soir d’aborder le second point concernant la formation et la vie d’un peuple, mais dans les deux cas, il y a un va-et-vient entre la vie de l’Eglise et la vie en société. Ils mettent en évidence, d’une façon peut-être inattendue, comment l’Eglise peut inspirer la société aujourd’hui.
-
La vie au gré des crises
« On ne sort jamais indemne d’une crise ; c’est une règle fondamentale. Si tu t’en sors, tu en sors meilleur ou pire, mais jamais comme avant ». Dès la première page, la franchise du ton est là. Le pape nous dit que dans la vie nous sommes tous mis à l’épreuve et que c’est ainsi que nous grandissons. Les crises nous révèlent, dans notre grandeur ou notre petitesse. Nous pouvons régresser ou créer quelque chose de nouveau. La crise est une opportunité pour changer, pour laisser la place à la nouveauté dont nous avons besoin. Pour cela, il faut se laisser toucher par la douleur des autres et oser rêver « en grand », concevoir de meilleures façons de vivre ensemble sur cette terre.
Le titre français du livre est « un temps pour changer » mais les titres originaux en espagnol et anglais sont « soñemos juntos / let us dream », c’est-à-dire « rêvons ensemble ». Le pape rêve d’un mouvement populaire généreux, qui abandonne l’individualisme comme principe d’organisation de la société, qui affirme que nous avons besoin les uns des autres, qui valorise le bien commun et se concentre sur la fraternité. Pour lui, des cœurs éprouvés par la crise peut jaillir un débordement de miséricorde, signe de la présence de Dieu parmi nous. L’idée que l’humanité pourrait sortir meilleure de la crise est pour François un motif d’espérance, mais pour cela il indique qu’il faut voir clair, bien choisir et agir correctement. C’est ce triptyque, un temps pour voir, un temps pour choisir, un temps pour agir, qui rythme le livre.
Il montre alors dans « un temps pour voir » comment une crise peut nous permettre d’élargir notre regard. Cela n’a rien d’automatique. Le narcissisme, le découragement et le pessimisme peuvent nous enfermer dans notre malheur et il faut les combattre. L’indifférence à la souffrance de l’autre peut aussi détourner notre regard et nous faire passer à côté des opportunités de changement. Mais un discernement est possible, nous pouvons nous laisser toucher par la souffrance des autres et nos yeux peuvent s’ouvrir aussi sur nos propres défauts. La Covid provoque aujourd’hui une mise à l’arrêt de la société, mais de telles mises à l’arrêt surviennent dans chaque vie. Nous avons alors besoin des autres. Nos « Covid personnelles » révèlent ce qui doit changer. Après avoir cité quelques exemples bibliques, le pape parle très ouvertement des trois crises personnelles qu’il a vécues et comment elles l’ont changé.
La crise en 1957 avec l’opération du poumon qui lui a failli couter la vie ; son séjour en Allemagne où il a fait l’expérience du déracinement et, surtout, l’épreuve d’une mise à l’écart avec un séjour de deux ans dans une bourgade en Argentine. Il en parle avec simplicité, posant un regard critique sur lui-même, analysant le comportement des autres, et admettant que ces crises l’ont marqué à vie.
Il conclut : « Ce que j’ai compris, c’est que tu souffres beaucoup, mais si tu te laisses transformer, tu en sors meilleur. Et si tu t’enfonces, tu en sors pire ». Le plus grand fruit d’une crise est pour lui : « la patience, saupoudrée d’un sain sens de l’humour qui nous permet d’endurer et de faire de la place pour que le changement se produise ». Avec en prime une lucidité qui lui fait dire que la bataille n’est jamais finie : le diable, une fois éloigné, peut encore renvoyer sept autres démons bien pires !
Ce sont de très belles pages, où le pape parle à hauteur d’homme, il n’y a pas angélisme naïf ni de défaitisme. Mais le conseil d’accepter la crise comme une occasion pour se laisser transformer, personnellement et collectivement. Et en ce sens-là, c’est un message d’espérance qui nous fait du bien.
-
Avancer ensemble avec nos différences
Entre le temps pour voir et le temps pour agir, il y a une phase de discernement nécessaire : le temps de choisir. Dans cette partie le pape explique le discernement des esprits. Il refuse à la fois une conception rigide de la vérité, comme si celle-ci était une entité statique, et le relativisme, qu’il qualifie de camouflage de l’égoïsme.
Comme indiqué, le pape rêve d’une société qui proposerait le principe de fraternité comme principe organisateur de la vie commune au lieu de l’individualisme. Cela implique de faire une unité, unité des cœurs et des esprits, qui respecte les différences. Alors qu’aujourd’hui, il y a un vrai risque de fragmentation de la société. Le pape dénonce une compétition où les adversaires cherchent seulement à s’annuler dans un jeu de pouvoir. Quand le dialogue sincère fait défaut, le résultat est une polarisation de toutes les questions politiques. Pour le pape, il ne s’agit pas d’éviter les conflits mais de s’engager dans le conflit, d’assumer le désaccord d’une manière qui empêche de tomber dans la polarisation. Affronter les divisions, tout en permettant à des nouvelles pensées d’émerger pour transcender les désaccords.
Pour cela le pape s’inspire de Romano Guardini et son concept de pensée « incomplète », inachevée. Le pape dit avoir appris de Guardini (sujet de sa thèse qu’il n’a jamais terminée) de ne pas exiger toujours des certitudes absolues, d’affronter les problèmes complexes en acceptant qu’ils ne peuvent être résolus par une simple application des normes. Qu’il est des moments où il faut laisser un espace pour la contemplation, le discernement pouvant se poursuivre plus tard. Une façon de penser qui, aux dires du pape, permet de naviguer dans les conflits sans se faire prendre au piège.
Il explique que Guardini fait la différence entre contradictions et contrapositions. La contraposition existe quand deux pôles sont en tension comme, par exemple, le local et le global. Ce sont deux visions différentes d’un même problème, mais il peut y avoir entre elles une tension féconde et créatrice. La contradiction, au contraire, oblige à choisir entre le bien et le mal. Il n’y a pas de tension féconde car l’un est la négation de l’autre.
Pour le pape, beaucoup de divergences relèvent des contrapositions mais, sous l’effet d’une pensée médiocre, il y a une tendance actuelle à les traiter comme des contradictions. Des politiques sans scrupules réduisent ainsi des problèmes complexes à des choix manichéens. De l’autre côté, il peut y avoir une volonté de nier la tension inhérente aux contrapositions. Le risque est alors de tomber dans le relativisme (tout se vaut) ou dans la paix à tout prix. Clairement, François refuse l’une et l’autre approche. Pour lui, il s’agit d’endurer le conflit, de discerner, pour essayer d’aller au-delà des apparences et ouvrir sur une nouvelle synthèse qui préserve les différents pôles. Lorsque le dialogue se fait dans la confiance et que tous acceptent de se mettre dans une humble recherche du bien commun, il peut y avoir alors une telle percée dans le dialogue, une solution inattendue, comme un don, un débordement. Ce débordement, le pape François y reconnaît la présence de Dieu.
C’est pour encourager de tels débordements que le pape a voulu remettre à l’honneur cette ancienne pratique dans l’Eglise qu’est la synodalité. Le but n’est pas tant de forger un accord que de reconnaître, d’honorer et de réconcilier les différences dans l’Eglise sur un plan supérieur où le meilleur de chacun peut être retenu. François fait le détour par la musique pour expliquer qu’il faut bien des notes différentes pour créer une harmonie. L’harmonie est plus riche que chaque note, plus complexe, plus inattendue, tout est dans l’articulation des singularités. Dans l’Eglise, c’est l’Esprit Saint qui crée l’harmonie. Cette harmonie nous permet d’avancer ensemble sur le même chemin (synodos), avec toute la palette de nos différences.
En cela, les pages du pape renvoient directement à ce que nous essayons de vivre à Promesses d’Eglise. Nous sommes différents, le CCFD et l’Emmanuel, pour ne prendre qu’un exemple, ce n’est pas la même façon de vivre sa foi. Mais il nous semble qu’il y a une tension féconde entre nous et nous espérons que quelque chose d’inattendue peut en sortir. Au moins, pour le moment, c’est une expérience très enrichissante pour nous-mêmes.
Mais, cela va plus loin. Cette nouvelle façon de vivre en Eglise est importante pour la société. Le pape le dit : « Cette approche synodale est quelque chose dont notre monde a grand besoin. Plutôt que de chercher la confrontation, de déclarer la guerre, chaque partie espérant vaincre l’autre, nous avons besoin de processus qui permettent aux différences d’être exprimées, entendues et maturées de manière à ce que nous puissions marcher ensemble sans avoir besoin de détruire qui que ce soit ».
Ici le lien entre transformation ecclésiale et sociale est évident. C’est parce que les catholiques arriveront à faire chemin ensemble en honorant leurs différences qu’ils vont pouvoir inspirer la société à vivre autrement les conflits et les désaccords. L’Eglise synodale n’est pas une Eglise qui dit aux autres ce qu’ils doivent faire ou pas faire. C’est une Eglise qui vit une expérience qu’elle cherche à partager avec la société. C’est une toute autre posture. C’est une exigence pour nous tous mais c’est aussi très enthousiasmant.
Le pape n’est pas naïf et dans les pages qui suivent il évoque les difficultés expérimentées lors des trois synodes qui ont déjà eu lieu (synode pour la famille, pour les jeunes et pour l’Amazonie). La synodalité commence avec l’écoute de tout le peuple de Dieu, une écoute réciproque et une écoute de l’Esprit Saint. La discussion pendant le synode ne porte pas sur les dogmes mais sur la façon dont l’enseignement de l’Eglise peut être reçu et vécu aujourd’hui. Dans cette discussion, la franchise est de rigueur et le pape trouve normal qu’il puisse y avoir des désaccords et des débats intenses. Certains ont bien essayé d’imposer leurs points de vue, de faire pression, de s’arroger le monopole de l’interprétation, révélant parfois des agendas cachés. Les médias ont souvent focalisé sur des points particuliers (divorcés-remariés, ordination des hommes mariés), passant à côté des véritables enjeux des synodes. Le pape n’ignore rien de tout cela et ne propose pas la synodalité comme un remède miracle. Il estime que nous pouvons tirer des leçons de l’expérience synodale.
D’abord, ce qui importe n’est pas tant d’arriver à un accord que de marcher ensemble, de s’écouter mutuellement dans le respect et la confiance, de croire en notre unité et d’accueillir la nouveauté que l’Esprit nous révèle.
Ensuite, c’est accepter de laisser place à un débordement, à l’émergence de solutions imprévues qui peuvent nous obliger à nous remettre en cause.
Enfin, c’est une nouvel apprentissage du temps dont le pape affirme toujours qu’il est supérieure à l’espace. La crise de la Covid peut nous aider car elle a modifié notre rapport au temps. Le temps appartient à Dieu et « notre Dieu est un Dieu de Surprises, toujours en avance sur nous ».
Ainsi ce livre du pape François nous encourage tous à continuer sur le chemin de la synodalité et Promesses d’Eglise ne peut que s’en trouver conforté dans sa démarche.
Dieu, un détour inutile
Louis-Marie Chauvet
Dieu, un détour inutile ?
Entretiens avec Dominique Saint-Macary et Pierre Sinizergues
Cerf, 2020, 348 pages, 22 €
Dans son enseignement de théologie fondamentale et sacramentaire à l’Institut catholique de Paris, le père Louis-Marie Chauvet a transmis à ses étudiants le goût de la pensée. Il donne dans ces entretiens, faits à la demande de ses interlocuteurs, un écho très porteur de ce que peut opérer la théologie dans une existence de croyant et de pasteur. La mention de son enfance et de sa foi heureuses en terre de Vendée avant le Concile ne conduit en rien à une nostalgie. La fidélité à cette enfance prend un autre chemin quand, arrivé à Paris, il s’agit de chercher et trouver comment vivre libre dans des conditions très différentes de celles qu’il avait connues jusqu’alors. La fréquentation des auteurs philosophes, théologiens, et de la psychanalyse aussi, rend pour lui, comme pour tant d’autres, la vie et la foi plus distinctes et plus libres. Cette libération par la réflexion théologique, qu’il dit avoir connue pour lui-même, il en donne les moyens à ses interlocuteurs et à ses lecteurs avec une volonté de centrer son propos sur ce qui, dit-il, est bien plus qu’un ensemble de valeurs : l’attachement au Christ et la forme eucharistique de la vie. Plus les entretiens avancent, plus les questions de théologie sacramentaire sont abordées. Elles le sont toujours à hauteur du questionnement des interlocuteurs, et donc du lecteur dont ils ont le souci, de telle sorte que ce livre propose sous forme vivante une très bonne introduction à la théologie, entendue sous l’angle de ce qu’il est nécessaire de comprendre pour vivre en Église de façon heureuse. Louis-Marie-Chauvet met au service de beaucoup de lecteurs sa grande amitié pour le « nous » qu’est l’Église.
Claire-Anne Baudin
Xavier de Verchère répond au questionnaire de Promesses d’Eglise

LePère Xavier de VERCHERE est salésien et Aumônier Général des Scouts et Guides de France
- Dans sa Lettre au Peuple de Dieu, le pape François appelle à une transformation ecclésiale et sociale qui passe par un refus de toute forme de cléricalisme. Quel lien faites-vous entre transformation ecclésiale et sociale ?
L’Eglise est à la fois une assemblée visible et une communauté spirituelle, institution et corps mystique qui veut se rendre présent au monde. Son lien à la société se situe dans un dialogue mutuel, en ayant un témoignage de foi et en recevant de la société une aide précieuse comme le rappelle le concile Vatican II. Or nous nous trouvons dans une crise ecclésiale profonde liée aux abus et dont la cause est le cléricalisme comme abus de pouvoir. Cette dérive affecte aussi la société. Face à cela, le Pape prend le problème à la racine. Il appelle tout le Peuple de Dieu à une transformation en profondeur qui commence par la conversion personnelle et se poursuit pour toucher toutes les structures. Dans ce processus, l’Eglise peut ouvrir une voie et montrer l’exemple, pas seulement par des mots mais par des actes. Et mieux, cette transformation ecclésiale peut catalyser positivement la société, car les chrétiens sont aussi dans le monde comme un ferment.
- Quels domaines ou quelles évolutions vous paraissent prioritaires aujourd’hui ?
Trois domaines me paraissent prioritaires : l’écoute des plus pauvres, la place des jeunes et le rôle des femmes dans l’Eglise. Diaconia a lancé une belle dynamique, l’option prioritaire pour les jeunes semble bien embarquée, mais pour ce qui concerne la responsabilité des femmes dans l’Eglise, le chantier n’en est qu’à ses débuts. Ces trois défis touchent trop à l’essentiel pour être simplement circonstanciels. Si nous étions convaincus que tout baptisé a une place et une mission à accomplir, si nous nous laissions davantage guider par le « sensus fidelium », nous éviterions cette dérive du cléricalisme. Ce sens de la foi est enraciné en tout membre du peuple de Dieu qui reçoit, comprend et vit de la Parole de Dieu dans l’Eglise, quel que soit sa condition. Donner la parole, c’est aussi écouter. Et l’écoute est une attitude spirituelle fondamentale : « Ecoute Israël » ! Ensuite, un autre enjeu plus vaste encore est certainement la synergie entre les diverses composantes ecclésiales. Comment diocèses, mouvements, associations, congrégations peuvent partager et œuvrer ensemble face aux enjeux du XXIè siècle ? C’est la démarche que cherche à engager Promesses d’Eglise.
- Quels obstacles ou quels points de vigilance voyez-vous sur ce chemin de la transformation ?
La tentation est de vouloir obtenir des résultats visibles rapidement et finalement de se décourager quand on ne voit pas de transformation. Le Pape pointe bien l’enjeu de la conversion qui est moins un effort sur soi qu’un travail de l’Esprit en soi. Il parle du jeûne et de la prière ! Le reste suivra. Il se situe en cela dans la sagesse d’un François de Sales invitant à commencer par l’intérieur. « Qui a gagné le cœur de l’homme a gagné tout l’homme. » Un autre obstacle serait de commencer par de « hauts débats » avant d’apprendre à se connaitre et faire corps. L’expérience d’être ensemble est première. Et on ne va au bout d’une aventure qu’avec des personnes que l’on connait bien ! Enfin, il faut accepter de se laisser déplacer en s’éduquant mutuellement, sans trop arrondir les angles systématiquement : quitter ses conceptions et sortir de sa zone de confort avec l’idée que chacun a une parcelle de vérité qui se révèle souvent au final en une tension fertile. Il faut aussi éviter de rester collé à sa propre réalité et prendre de la hauteur : l’Eglise a reçu une mission de service de l’Evangile, ce n’est pas le moment de tomber dans les mesquineries ou les egos.
- Quel signe ou quelle expérience concrète vous fait dire que cette transformation est déjà en marche ou en tout cas possible ?
Grâce à cette crise ressort une plus grande liberté de parole dans l’Eglise. C’est toujours positif et sain quand dans une famille on s’assoie et on parle librement de sujets importants. Il y a beaucoup d’expérience peu ou mal connues qui ne sont pas capitalisées. Promesse d’Eglise en est le réceptacle. Au niveau des Scouts et Guides de France, au-delà de certains acquis comme la promesse, le jeu des conseils, la relecture, les responsabilités qui seraient à diffuser vu les fruits éducatifs et spirituels que l’on découvre, il y a aussi le « conseil des jeunes » initié en 2019. Il est le fruit d’une réflexion des SGDF sur l’éducation à la prise de décisions et à la citoyenneté dans le processus démocratique de l’association. Un conseil des jeunes est un espace dans lequel les jeunes s’expriment librement et où leur parole n’est pas influencée par les adultes. Ils échangent, débattent, délibèrent et le résultat de leurs discussions est porté aux différentes instances de l’association. Et cela marche très bien ! Nos jeunes confirmés dans l’Eglise pourraient avec ce modèle trouver davantage de place dans les instances et apporter un souffle certain.
Françoisphobie
Yves Chiron, Françoisphobie, Cerf, 2020, 352 pages, 20 €
Les attaques contre le pape François provenant de l’intérieur de l’Église, y compris de cardinaux, contrastent avec la popularité dont il bénéficie à l’extérieur. L’historien Yves Chiron propose un parcours de diverses « affaires » qui ont défrayé les chroniques médiatiques. Une attention particulière est donnée au cas de Mgr Carlo Viganò qui apparaît de plus en plus comme le « Grand Accusateur ». En dépit des apparences, les accusations de « rupture » à l’égard de ses prédécesseurs ne reposent sur aucun fondement. L’auteur s’efforce de montrer que François n’est en aucune façon un « novateur » mais un « continuateur », que ce soit à propos de la réforme de la Curie, de la discipline ecclésiale (ordination presbytérale d’hommes mariés, voire de femmes) ou des doctrines morales (contraception, avortement, euthanasie, etc.). La démonstration repose sur une riche documentation, en particulier les nombreux sites « vaticanistes » peu connus en France. Il aurait été intéressant de prolonger l’analyse en montrant que la continuité sur le contenu (comment pourrait-il en être autrement ?) fait ressortir par contraste la nouveauté dans le « style ». Une parole personnelle, imagée, directe ouvre au dialogue, bien plus qu’un discours « dogmatique ». L’important est que, sur les questions abordées, des débats s’instaurent, loin des polémiques stériles et fastidieuses.
François Euvé