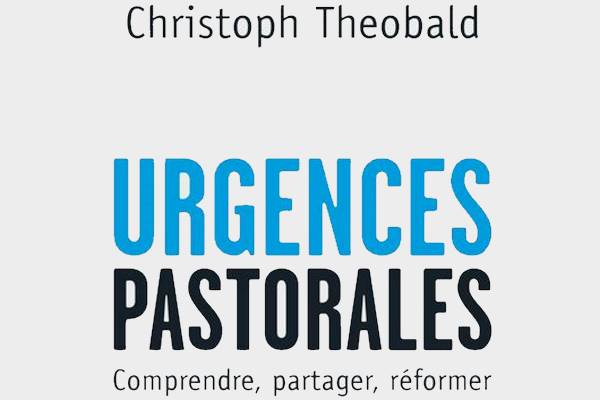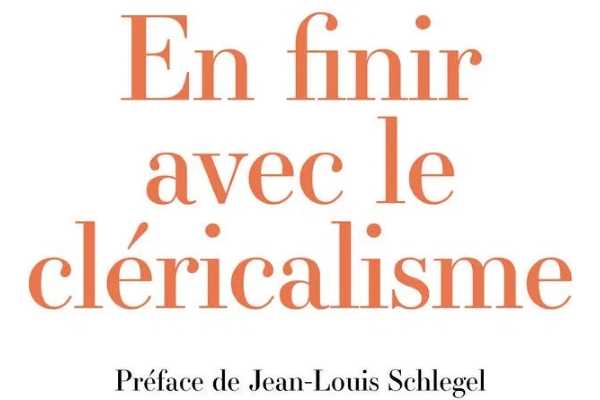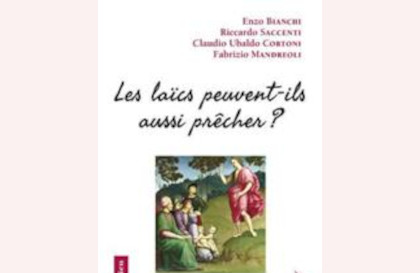La formation des prêtres
Urgences pastorales, Comprendre, partager, réformer
Christoph Theobald, Editions Bayard, 540 p.
Le projet du livre de Christoph Theobald est d’inciter l’Église à retrouver un dynamisme missionnaire. Et cela passe par une réforme, un combat spirituel qui « porte sur la capacité des chrétiens et de leurs Églises à mettre l’Évangile du Règne de Dieu à la disposition de toute l’humanité et de toute la terre comme ‟ressourceˮ salvatrice, au moment où les hommes et femmes habitant sur notre planète se trouvent confrontés à des défis d’une ampleur inédite » (p. 13).
L’auteur, dans une première partie intitulée « S’asseoir… Diagnostic du moment présent » nomme et met en perspective quelques-uns des défis actuels : montée de l’islam, extension des zones de pauvreté, intensification des flux migratoires, crise écologique, évolution du rapport à la mort, fantasmes du transhumanisme… De nouvelles manières d’habiter le monde se cherchent, marquées par une exigence de respect de l’autonomie personnelle, un souci aigu de la qualité de l’existence quotidienne, le sens d’une solidarité fraternelle large, la conscience que nous sommes devant des échéances cruciales pour l’avenir de notre planète. Beaucoup – des jeunes notamment –, conscients de ce qui est en jeu, sont prêts à s’engager et à payer de leur personne. Il y a ici un potentiel de créativité insoupçonné. Or la « proposition de sainteté » que l’Église donne à percevoir rejoint difficilement ces aspirations nouvelles. À tort ou à raison, elle est perçue comme légaliste, abstraite, trop préoccupée de sexualité ; elle parvient mal à donner à goûter ce qu’elle porte en son cœur, « à savoir la gratuité du don de la vie » que l’on peut à son tour « engager librement et gratuitement » (p. 84).
Pour Christoph Theobald, cela incite à redécouvrir un trait majeur du Christ : son existence est marquée de part en part par l’hospitalité. Son accueil de la vie comme don gratuit ouvre un espace pour chacun qui se voit ainsi remis en chemin, promis à une nouvelle genèse ; en réponse, certains engageront à leur tour leur vie sur ce mode gracieux. Cette vision de la mission du Christ qui, à la fois, se confronte aux réalités les plus dures et ouvre à de nouveaux commencements, inaugure une manière d’habiter le monde capable de résonner avec les urgences de l’époque et de faire pièce aux tentations du cynisme, du fatalisme ou du repli narcissique.
Or, un aspect important de l’affaiblissement de l’Église catholique (peut-être son principal problème) vient, selon l’auteur, de sa difficulté à prendre vraiment au sérieux sa propre source – cet évangile de l’hospitalité – et à se laisser renouveler, transformer par elle. Souvent encombrée par le souci de sa propre perpétuation, elle a bien du mal à laisser l’Esprit donner naissance à des figures nouvelles. Elle parvient difficilement, par exemple, à penser la communauté chrétienne plus largement que selon le mode paroissial, construite autour du ministre ordonné et accaparée avant tout par les services religieux (funérailles, baptêmes, mariages). Christoph Theobald, soucieux de l’enracinement local de l’Église, propose de « laisser advenir de véritables communautés sur place » qui soient « sujets collectifs » et « missionnaires pour leur environnement » (p. 324). Cela suppose aussi de passer à une nouvelle figure du pasteur, « passeur » plutôt que « pivot » (p. 329-332), autrement dit, quelqu’un dont la mission soit moins celle d’un chef d’orchestre obligé de veiller à tout, que celle d’un ministre soucieux du déploiement des charismes de chacun et de leur heureuse conjonction au service de l’Évangile, quelqu’un qui soutienne, relance, réconcilie, mette en relation, aide à entendre les appels et à y répondre. Une telle figure de pasteur ne reste pas longtemps seule, elle suscite d’autres ministères. L’auteur en nomme quelques-uns : autour de la gouvernance des communautés locales, au service de la Parole (catéchèse, liturgie, groupes bibliques) ; il esquisse aussi un « ministère d’hospitalité » qui serait responsable de l’ouverture de la communauté, de sa capacité d’accueil et de son intérêt pour son environnement (p. 336).
En somme, la proposition de Christoph Theobald est une invitation pour l’Église à se laisser questionner par ce que vivent nos contemporains, avec la confiance que, de cette rencontre, ne peut surgir qu’un surcroît de vitalité évangélique. Bien sûr, les axes ainsi ouverts sont faits pour être débattus (pour ma part, je serais enclin à insister davantage sur une présence prioritaire à ceux qui vivent des situations de grande détresse, ce qui permet de mieux honorer, je crois, le rendez-vous pascal de la vocation chrétienne).
Eh bien, avec tout cela, il y a de quoi faire un concile de l’Église de France, non ?
Étienne Grieu sj
L’invention de l’Église.
Essa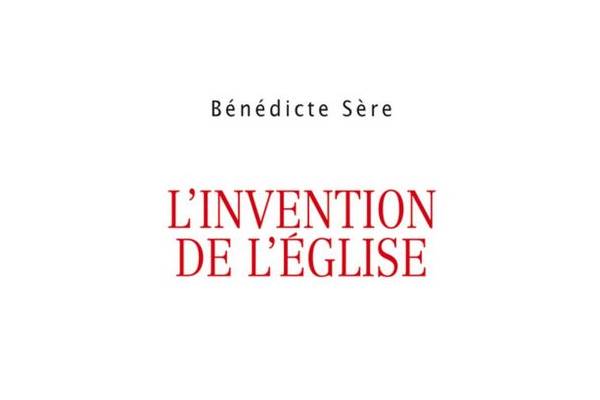 i sur la genèse ecclésiale du politique entre Moyen Âge et Modernité
i sur la genèse ecclésiale du politique entre Moyen Âge et Modernité
Bénédicte Sère, Edutions PUF, 2019, 288 p.
L’invention de l’Église dont il est ici question est celle des historiens-théologiens qui ont inspiré et accompagné le concile de Vatican II (en France, principalement Marie-Dominique Chenu et Yves Congar), en puisant aux sources de l’époque du Grand schisme et des débats conciliaires du XVème siècle. L’auteure entend montrer comment « l’Église a continûment manipulé l’histoire de son propre passé pour construire sa mémoire et se mettre en récit, en un va-et-vient constant entre Moyen Âge et Modernité, voire Contemporanéité ». Elle le fait en sept essais d’historiographie critique autour des notions de conciliarisme, de constitutionnalisme, de collégialité, de réformisme, d’antiromanisme, de modernisme et d’infaillibilisme. À propos de chacune d’elle, elle analyse quel usage en a été fait du Moyen Âge aux XIXème et XXème siècles, que ce soit par les partisans ou par les adversaires de la collégialité ou de l’infaillibilité par exemple. L’auteure invite à un retour aux archives et à une nouvelle lecture de sources, parfois inédites, du Moyen Âge, pour les confronter aux récits devenus canoniques des manuels d’histoire religieuse. On comprend avec elle que la collégialité épiscopale contemporaine n’a rien à voir avec celle des assemblées synodales et conciliaires du XVème siècle, alors qu’à l’inverse, l’infaillibilité pontificale n’est pas une idée neuve au XIXème siècle. Elle est apparue au XIVème siècle mais, paradoxalement, pour limiter le pouvoir pontifical, empêchant un pape à venir d’invalider les décisions d’un pontife précédent. En affirmant sa volonté de « faire de l’histoire religieuse en vue d’autre chose que le religieux », Bénédicte Sère apporte une contribution critique et des matériaux décisifs aux réflexions ecclésiologiques en cours.
Michel Sot
En finir avec le cléricalisme
Loïc de Kerimel, Préface de Jean-Louis Schlegel, Editions Seuil, 2020, 304 p.
Dans sa « Lettre au peuple de Dieu », le pape François identifie la cause principale des abus dans l’Église au « cléricalisme ». Mais que signifie ce terme, et d’où vient-il ? Et comment en sortir ? Tel est le propos de Loïc de Kerimel dans un livre qui propose un vaste parcours historique des deux mille ans d’histoire de l’Église. Il faut en effet remonter au commencement pour voir quand et comment s’est formé le couple clerc-laïc, absent du Nouveau Testament. On est passé d’un « peuple de prêtres » au « peuple des prêtres ». Ce qui se donne à voir dans l’Évangile est, au contraire, la fin des sacrifices, la déchirure du « rideau du Temple » qui séparait l’espace sacré (« pur ») de l’espace profane (« impur »). Mais diverses influences ont conduit très tôt à réimplanter un fonctionnement hiérarchique de la communauté chrétienne (dédoublé par la minoration des femmes, « laïcs au second degré ») et à donner une importance centrale à la notion de sacrifice. Par réaction à la Réforme, le concile de Trente renforce cette tendance. La thèse de l’auteur est que la séparation avec le judaïsme (qui deviendra une hostilité) est l’une des causes de cette dérive, dans la mesure où le judaïsme synagogal renonce, quant à lui, à tout sacerdoce. La relation rétablie au concile Vatican II est un signe d’espoir. Historiens et théologiens pourront débattre de la position engagée de l’auteur, appuyée, il faut le souligner, sur de bonnes références.
François Euvé
Réparons l’Église, Scandales, abus, révélations.
Dominique Greiner, Préface de Marie-Dominique Trébuchet. Postface de Luc Forestier, Editions Bayard, 2020, 130 p.
Une enquête réalisée par un questionnaire auprès des lecteurs de La Croix et du Pèlerin, de mars à juin 2019, sur le thème « Réparons l’Église », a suscité près de 5 000 réponses. L’ouvrage de Dominique Greiner, rédacteur en chef à La Croix, livre de façon structurée ce matériau au contenu à la fois riche et convenu. Riche car, par leur nombre même, les réponses manifestent une grande attente et un questionnement fécond vis-à-vis de l’institution. Convenu car la crise semble avoir pour principal effet de renforcer chacun dans ses convictions, sans que se créent véritablement des passerelles ni que s’esquissent des perspectives pour « mieux faire » (plutôt que « réparer ») l’Église. Quant au volet de « préconisations », rien de vraiment neuf n’émerge : la mise en œuvre de Vatican II a encore de beaux jours devant elle… C’est de l’Église comme institution qu’Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à La Croix, voulait se mettre à distance (avant d’y revenir…), en prenant son bâton de pèlerin, le nez au vent, pour parcourir la France de (quelques) personnalités « cathos » engagées dans une variété de ministères, de situations de vie, de statuts sociaux… « Ce dont nous avons besoin, c’est de savoir ce que signifie, aujourd’hui, être catholique. » Pour répondre à cette vaste interrogation par temps de crise, une belle galerie de rencontres nous est proposée, parcourue par une grande liberté de ton, avec parfois des accents très personnels, que ce soit de l’autrice elle-même ou de ses interlocuteurs. Pas de solutions toutes faites, pas (trop) de propos définitifs, simplement des parcours de vie qui tentent d’apporter des réponses particulières à « la seule question qui vaille […] : comment on vit soi-même l’Évangile » (François Sureau). Un dernier mot qui en appelle bien d’autres…
Antoine Corman
Les laïcs peuvent-ils aussi prêcher ?
Enzo Bianchi, Claudio Ubaldo Cortoni, Fabrizio Mandreoli et Riccardo Saccenti, Editions Lessius « La part-Dieu », 2020,136 p.
La question de la prédication est d’actualité dans l’Église catholique. Le magistère fait régulièrement mention des difficultés qu’elle suscite et bien des chrétiens, qui sont aussi des chrétiennes, s’interrogent sur une pratique qui reste essentiellement réservée, verrouillée. Alors que l’homélie engendre beaucoup d’indifférence, d’ennui, parfois de rejet, les textes magistériels renchérissent depuis les années 1990 sur le lien qui unit cet acte liturgique à la personne du « ministre sacré ». Pourtant, la prise au sérieux de l’identité baptismale, avec la dimension missionnaire qui lui est attachée, impose de s’interroger sur le plein exercice de la diaconie de la Parole au sein de l’ensemble du peuple chrétien. Or il se trouve que l’histoire de l’Église elle-même provoque à ouvrir le débat. C’est la vertu de ce livre, qui convoque la parole d’historiens, de faire la démonstration que la question a occupé d’autres époques, qu’elle fut objet de controverses intenses où elle reçut des réponses diverses, incluant en certains temps la reconnaissance d’une prédication exercée par des laïcs, y compris par des femmes. Grâce à ces pages, on accédera ainsi à l’histoire complexe de la réforme grégorienne qui, au XIIe siècle, avait déjà affaire à des questions de pleine actualité autour du laïcat et de l’exercice de la parole d’enseignement et de prédication. Les perspectives qu’ouvre Enzo Bianchi, en introduction, invitant à un renouvellement de notre pratique contemporaine, se trouvent ainsi appuyées et légitimées par une tradition qui, bien comprise, se manifeste comme principe de liberté et d’innovation. Des annexes donnent accès à des documents précieux, qui vont de l’époque de Pierre Damien (1007-1072) à la nôtre.
Anne-Marie Pelletier
L’Église, des femmes avec des hommes
Anne-Marie Pelletier, Editions du Cerf, 2019, 248 p.
Selon son « ouverture », l’ouvrage prolonge en l’enrichissant Le signe de la femme (Cerf, 2008), grâce à d’autres travaux parus auparavant et entretemps. L’« envoi » final rappelle que « la jubilation du Cantique des cantiques sera l’unique et définitive vérité de l’humanité ». Le bilan du premier chapitre porte sur « la manière dont s’est vécue la relation entre l’institution ecclésiale et les femmes depuis les dernières décennies », surtout du point de vue de l’exercice de l’autorité, sous l’angle du rapport entre sacerdoce baptismal et ministère presbytéral. Deux chapitres légitiment ensuite la plus valable des lectures féministes de l’Écriture. Des écueils sont pointés : « un monde défavorable aux femmes », certains ravages d’un ordre patriarcal et les périls de la métaphore féminine dans la théologie de l’Alliance. Mais des surprises vétérotestamentaires valorisent maintes « femmes vaillantes », destinées à introduire « l’Évangile des femmes ». « Le temps des femmes, quelle chance pour l’Église ? », se lit comme le chapitre le plus novateur, d’une prose admirable, nourrie d’auteurs anciens et actuels, en faveur de la vie et de la sainteté du Corps entier. « Éclats de féminin. Petit inventaire du “signe de la femme” » conclut la trajectoire d’une concision scrupuleuse, tant sont pesées expressions et citations aux enjeux décisifs. Une borne milliaire, d’ores et déjà, sur le sujet d’« une théologie approfondie du féminin », appelée de ses vœux par le pape François dès l’aube de son pontificat.
Yves Simoens