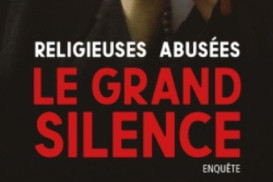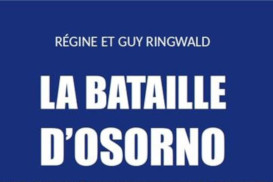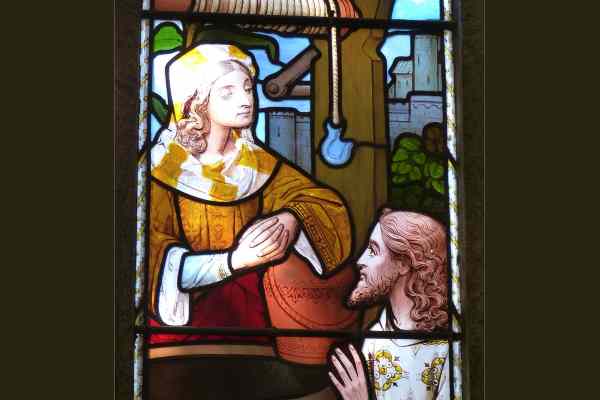La formation des prêtres
Le grand silence
Constance Vilanova
Religieuses abusées.
Le grand silence, Artège, 2020, 216 pages, 17 €
Préface de Stéphane Joulain
Durant l’été 2018, une nouvelle vague de révélations d’abus sexuels dans l’Église éclate. Les victimes sont cette fois des adultes, des religieuses, et les auteurs des crimes des prêtres, des religieux, des évêques, au Chili, en Italie, en Inde… En France et en Allemagne, c’est en mars 2019 que le documentaire d’Arte « Religieuses abusées », révèle au grand public et aux fidèles atterrés cette réalité. La parole de ces religieuses, longtemps tue, voire étouffée, commence donc elle aussi à se « libérer », profitant sans doute des portes ouvertes à la fois par les victimes de la pédocriminalité dans l’Église, et par le mouvement #Metoo. La journaliste Constance Vilanova nous livre dans ce livre à la couverture et au titre inutilement accrocheurs son enquête sur le sujet. Enquête difficile pour elle, qui répète avoir souvent eu l’impression de se heurter à un « grand silence ». Enquête sérieuse en même temps : elle retrouve les rapports de religieuses missionnaires qui, il y a trente ans, dénonçaient déjà ces abus devant les instances romaines. Elle donne également la parole à des « lançeuses d’alerte » passées ou actuelles, à des témoins, à des victimes, mais aussi à des responsables ecclésiaux, qui tous et toutes tentent de parler, de dénoncer le sort souvent réservé à ces religieuses (obligation au silence, culpabilisation, exclusion de la communauté, parfois avortement imposé), de les accompagner et enfin d’éclairer les mécanismes qui favorisent ces abus : la dépendance matérielle ou spirituelle de certaines sœurs, la place des hommes dans certaines cultures, et, partout, la tendance à sacraliser la place du prêtre ainsi qu’à pratiquer « la culture du secret » dans l’Église.
Emmanuelle Maupomé
La bataille d’Osorno
Régine et Guy Ringwald
La bataille d’Osorno
Temps Présent/Golias, 2020, 290 pages, 19 €
Le titre de cet ouvrage fait référence aux combats menés par les laïcs d’Osorno (Chili), face à leur évêque Mgr Juan Barros, nommé en janvier 2015 par le pape malgré sa proximité avec le très fameux père Fernand Karadima, qui fut jugé et condamné par l’Église en 2011 pour pédophilie. C’est tout le fonctionnement de l’empire Karadima qui est ici exposé, ses alliances avec Augusto Pinochet et avec la bourgeoisie de Santiago, la capitale, ses méthodes perverses de contrôle spirituel dans sa paroisse d’El Bosque et les abus sexuels qu’il a perpétrés depuis les années 1960. La nomination à l’évêché d’Osorno de Juan Barros, un de ses protégés, pousse de nombreux laïcs à se faire entendre fortement, avec l’appui des victimes de Karadima. Le voyage du pape au Chili en janvier 2018, sa défense de Mgr Barros puis sa découverte d’une culture des abus dans ce pays a montré l’ambigüité de la hiérarchie (le nonce apostolique, le cardinal de Santiago etc.) face à ces drames. Après un traitement de choc, le pape ayant demandé la démission de tous les évêques chiliens, il semble que la routine administrative ait repris le dessus. Tous ces événements sont racontés avec force détails, lettres, analyses, déclarations. Ce volume déjà éprouvant à parcourir par le caractère bouleversant de son sujet s’achève sur un chapitre concernant le jésuite Renato Poblete, très célèbre au Chili, décédé en 2010. Sa double vie, entretenue par l’argent et le pouvoir, a été révélée en avril 2019 par une de ses victimes devenue son « esclave sexuelle » pendant huit ans dans les années 1980-1990. Ce récit résume tragiquement toutes les compromissions de l’Église face aux abus sexuels.
Pierre de Charentenay
Plaidoyer pour la juste place des femmes, ACF 2015
Nous vous proposons ce texte de l’Action Catholique des Femmes, toujours d’actualité.
Vous pouvez le visualiser en suivant ce lien
Vincent Leclair répond au questionnaire de Promesses d’Eglise
« l’impression de déclassement ecclésial qu’il y a à vivre le laïcat
comme une vocation. »

Le texte de l’entretien avec Vincent Leclair est téléchargeable en cliquant ici
Vincent Leclair, 62 ans, laïc marié, père de 3 enfants, vivant à Béziers. Instituteur dans l’enseignement public jusqu’en 2019. Aumônier de prison de 2000 à 2015, aumônier général des prisons de 2009 à 2015. Membre d’une EAP (équipe d’animation pastorale) et de l’équipe diocésaine de diaconie-solidarité. Engagé dans deux mouvements de spiritualité. Actif dans le monde associatif local.
1. Dans sa Lettre au Peuple de Dieu, le pape François appelle à une transformation
ecclésiale et sociale qui passe par un refus de toute forme de cléricalisme. Quel lien
faites-vous entre transformation ecclésiale et sociale ?
La transformation est nécessairement ecclésiale et sociale parce qu’elle touche à la vie
interne de l’Eglise et à son rapport à la société. Il me semble indispensable de garder le lien
entre cette transformation et le refus du cléricalisme dont parle le Pape.
Le cléricalisme est une maladie de l’organisation qui tend à confisquer ce qui est à tous au
profit de quelques-uns, à sacraliser une élite et à favoriser un fonctionnement
discriminatoire. Si ce modèle n’est pas vécu aussi durement dans la réalité ecclésiale, il y est
cependant très profondément intériorisé. Je voudrais en donner deux exemples. Voici le
texte d’une Invitation reçue lorsque je travaillais à la CEF : « les évêques en assemblée
plénière dans la maison invitent les prêtres, religieuses, religieux, diacres, salariés et
bénévoles au café dans le jardin » ; c’était une invitation envoyée selon les statuts de
chacun, descendante. Elle aurait pu être adressée aux personnels d’entretien, assistants,
collaborateurs et directeurs de services ; cela aurait été une invitation par fonctions,
ascendante. Mais, surtout, plus simplement, n’aurait-elle pas dû être adressée à tout le
monde sans distinction, invitation fraternelle, évangélique?
Deuxième exemple. Confinés pour Pâques, nous avons suivi en famille la veillée pascale à la
télévision. Au moment de la communion la vingtaine de prêtres présents a communié à
l’autel au même calice, les diacres et séminaristes ont communié ensuite, au fond du choeur,
les deux laïcs qui assuraient l’animation n’ont pas communié. La prescription sanitaire (un
seul, le célébrant, communie) a été détournée en attitude discriminatoire.
Ce schéma s’articule avec une conception étriquée de la vocation, élitiste et sacralisé. Ainsi,
dernièrement, à la messe en semaine, dans un texte de prière pour les vocations, nous avons
rendu grâce pour les vocations d’apôtres, de saints, de prêtres, de religieux et de religieuses
(et, ce fut ajouté au texte, des consacrés). Mais il ne fut question ni des diacres ni des laïcs.
Ici, le cléricalisme distingue les célibataires volontaires et les autres… Qu’advient-il de cette
vision des choses devant le scandale des abus sexuels?
Personnellement, au terme d’un long discernement, j’ai renoncé au diaconat auquel j’étais
appelé, parce que je n’y ai pas reconnu ma vocation. Je ressens chaque jour
l’incompréhension, l’impression de déclassement ecclésial qu’il y a à vivre le laïcat comme
une vocation.
Cette ambiance cléricaliste retentit sur l’image de l’Eglise dans la société. Elle apparaît
comme une institution désuète, un élément du patrimoine, nécessaire pour donner du
lustre. Cet aspect visible et stable semble rassurant dans une société incertaine. Il s’appuie
sur des éléments identitaires, peu évangéliques à mon point de vue (des titres, des habits
cléricaux, des traitements dérogatoires, des rites publics…)
Par ailleurs, l’Eglise se présente comme une experte en surplomb , mettant les autres sous
tutelle. Par exemple, pour accompagner la communication à l’Administration Pénitentiaire
d’un document de l’aumônerie des prisons sur la réinsertion, un évêque avait rédigé un petit
mot indiquant que l’Eglise catholique était prête à accueillir tous ceux qui souhaiteraient
travailler avec elle. La formule a finalement été changée pour dire que l’Eglise était heureuse
de s’engager aux côtés de tous ceux qui agissaient sur ce terrain !
2. Quels domaines ou quelles évolutions vous paraissent prioritaires aujourd’hui ?
Ce qui me semble indispensable pour faire avancer la transformation, c’est, à l’intérieur de
l’institution, de remettre à plat les notions de vocation, de ministère, de sainteté qui
séparent les croyants et d’en renouveler la compréhension en termes d’humilité,
d’ouverture à la miséricorde, de communauté et de fraternité.
Vis-à-vis de l’extérieur, l’Eglise doit vraiment se reconnaitre et se comporter comme une
institution immergée et solidaire de la société, touchée par les mêmes questions, faiblesses
et limites humaines et organisationnelles. En conversation avec le monde … (1)
3. Quel signe ou quelle expérience concrète vous fait dire que cette transformation
est déjà en marche ou en tout cas possible ?
Ce qui me donne espoir, malgré le retour préoccupant de signes distinctifs du cléricalisme,
c’est mon histoire personnelle qui m’a conduit, croyant ordinaire, à exercer une
responsabilité ecclésiale nationale et à la vivre en toute confiance et reconnaissance avec de
nombreux clercs et laïcs, à l’intérieur de l’Eglise et au dehors. Les jeunes générations, aussi,
me donnent de l’espoir. Elles ont souvent une vision bien différente de la mienne que je
peux juger naïve voire rétrograde. Mais elles inventent de nouvelles manières de vivre leur
foi qui déplacent et apaisent le rapport au ministère, à la vocation, à la sainteté. Je le vois en
particulier avec les jeunes laïcs en mission ecclésiale (LEME) de mon diocèse.
‘(1) “Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni
par les coutumes… ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et
le reste de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales
de leur manière de vivre… Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des
étrangers domiciliés… Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une
terre étrangère.
De la Lettre à Diognète, n° 5-6 extraits
Véronique Margron répond au questionnaire de Promesses d’Eglise
« La transformation à laquelle le pape appelle l’Eglise peut bénéficier à tout le corps social »
Véronique Margron o.p. est prieure des Dominicaines de la Présentation pour la province de France et présidente de la CORREF (la Conférence des religieuses et religieux en France). Elle est également théologienne moraliste et ancienne doyenne de la Faculté de théologie de l’Université catholique d’Angers. Elle est l’auteure de nombreuses livres dont le dernier, « Un moment de vérité », analyse la crise que traverse l’Eglise.
-
Dans sa Lettre au Peuple de Dieu, le pape François appelle à une transformation ecclésiale et sociale qui passe par un refus de toute forme de cléricalisme. Quel lien faites-vous entre transformation ecclésiale et sociale ?
Lutter contre les abus sexuels, de pouvoir et de conscience, implique le refus du cléricalisme. Cela passe par une transformation des structures et des mentalités qui, en Eglise, sont portées par une théologie et une ecclésiologie. La façon dont une communauté réagit et prend la parole révèle le jeu triangulaire entre mentalités, structures et théologie ou parfois même idéologie. Ainsi, dans l’esprit encore de beaucoup de personnes, le curé est le « patron ». Elles acceptent qu’il parle à leur place et en leur nom et ne contestent pas sa parole. Les relations sont trop à sens unique, il n’y a pas assez de place pour la réciprocité. De telles relations existent également dans la société qui connaît tragiquement aussi des cas d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience. La transformation à laquelle le pape appelle l’Eglise peut ainsi bénéficier à tout le corps social. En vivant sa propre transformation, l’Eglise pourrait participer à soutenir la société dans sa lutte contre les abus.
-
Quels domaines ou quelles évolutions vous paraissent prioritaires aujourd’hui ?
Le plus important me paraît de consentir à l’esprit critique, à tout ce qui combat la servilité et la passivité. Dans des instituts où il y a eu des abus, la pensée critique n’était pas possible. Ceux qui émettaient une opinion divergente étaient jugés réfractaires ou hérétiques. Le terreau des abus et du silence est là. Il faut oser nommer les choses, appeler un chat un chat, avoir « l’insolence de la parole ». C’est le titre d’un petit livre de Marie Cénec, une pasteure protestante qui a dû se libérer d’une emprise religieuse. La Parole de Dieu rend libre et notre parole peut et doit aussi être une parole libre ; responsable et libre. Avoir un esprit critique et une parole libre implique une bonne formation des laïcs, comme le Concile Vatican II le recommandait déjà. Cela va de pair avec l’acceptation de la pluralité, de l’altérité et du débat. Nos communautés paroissiales doivent pouvoir débattre et apprendre à vivre la contestation comme un lieu créatif, une modalité pour chercher ensemble comment se mettre au service du bien commun. Plus la pluralité et l’altérité sont respectées, plus les plus vulnérables seront protégés, car il y aura de l’espace pour la vigilance. Une communauté paroissiale doit aussi être en capacité de distinguer ce qui relève du sacerdoce ministériel (du prêtre) et ce qui n’en relève pas. Une bonne compréhension et un juste partage des responsabilités permet d’éviter que le « sacré » ne prenne trop de place.
-
Quels obstacles ou quels points de vigilance voyez-vous sur ce chemin de la transformation ?
La situation est probablement différente dans les campagnes et dans les villes. Dans les zones rurales, les catholiques ont pris en charge depuis longtemps la vie de l’Eglise, sans que cela soit d’ailleurs particulièrement mis en valeur. En ville, les catholiques peuvent encore se comporter comme des consommateurs. Ils ne sont pas sollicités pour être actifs autrement qu’en rendant service. En même temps, il faut reconnaître que les contraintes professionnelles et familiales font que tous ne peuvent pas être engagés à fond dans leur paroisse. La messe dominicale doit aussi rester un moment de respiration pour ceux qui peinent le reste de la semaine. Il y a donc une vigilance à avoir dans les communautés pour ne pas épuiser les bonnes volontés, ni se laisser créer des bastions de pouvoir. Cela demande une certaine plasticité, de trouver la bonne mesure. Un autre point de vigilance est la formation des séminaristes. Ces jeunes sont souvent, aujourd’hui, issus des mêmes milieux et la question identitaire est importante pour cette génération. Ce n’est pas un reproche, la question est de savoir comment la formation va les déplacer et les accompagner. Elle ne doit pas renforcer le modèle identitaire ou l’entre soi, ni les infantiliser. Des formations communes avec des laïcs et un accompagnement par des laïcs peuvent être des pistes.
-
Quel signe ou quelle expérience concrète vous fait dire que cette transformation est déjà en marche ou en tout cas possible ?
Les discours et les actes du pape François sont un signe d’espérance ! Sa vision d’une Eglise pauvre pour les pauvres, hôpital de campagne, à l’écoute des joies et des peines du monde redonne confiance à beaucoup. L’Eglise est déjà plurielle à l’échelle mondiale. Dans beaucoup de parties du monde les chrétiens se sont organisés et ont su transmettre l’Evangile même en l’absence de prêtres. L’exemple de l’Amazonie mais aussi des Eglises qui ont vécu dans la clandestinité, comme du temps de l’URSS, doivent nous instruire sur ce qui est essentiel pour la transmission. Un autre signe d’espérance est l’engagement de tant de laïcs pour cette transformation ecclésiale et sociale. Ils se sentent souvent seuls et ont besoin d’être encouragés. Bon nombre de clercs y sont engagés aussi et selon les lieux, ils sont contrés ou soutenus. Plus il y aura de la place pour la pluralité dans l’Eglise, plus tous ceux qui souhaitent sa transformation se sentiront encouragés. La prise de conscience des laïcs est fondamentale pour la lutte contre les abus en tout genre. Aujourd’hui les catholiques n’acceptent plus des choses qui sont passées inaperçues à d’autres époques. J’ai confiance que leur foi, leur esprit critique et leur liberté de parole aideront à transformer l’Eglise.
Mgr Tomas Halik : La révolution de la miséricorde et un nouvel œcuménisme
Nous proposons cet article de Mgr Tomas Halik, paru dans La Croix le 3/12/2020.
Merci à La Croix de nous permettre de publier ce texte.
Professeur de philosophie et de sociologie de la religion à l’Université Charles de Prague, Mgr Tomas Halik s’inquiète du fossé qui grandit au sein de l’Église catholique entre partisans d’une religion légaliste, tournés vers le passé, et défenseurs d’une révolution de la miséricorde, attentifs aux signes des temps.
Il y a quelques semaines, des nouvelles percutantes du Vatican ont fait la une des principaux journaux du monde. Le Pape François évoquait les homosexuels et leur droit à aimer d’une manière très humaine. Soutenant l’idée d’union civile entre personnes de même sexe, il a parlé comme s’il n’y avait pas eu de longs siècles de peur, de préjugés et de haine à l’égard des personnes non hétérosexuelles, des préjugés qui ont causé de nombreuses tragédies humaines et en ont poussé beaucoup au suicide.
Ce n’est pas ce que le Pape a dit exactement dans ce documentaire qui est crucial ; son soutien aux « unions civiles » (et non au « mariage ») des personnes LGBT et à une approche humaine de ces dernières est connu de longue date et se retrouve dans beaucoup de ses déclarations passées.
J’attendais quant à moi la réaction des ennemis de François. Y aurait-il encore de nouvelles «corrections filiales» de la part d’un groupe de théologiens conservateurs et des «dubia» (doutes, objections) de la part de certains cardinaux ? Cela s’était produit précédemment, quand, dans son encyclique Amoris Laetitia, le Pape François avait mentionné avec sensibilité que toutes les personnes divorcées et remariées ne devaient pas être brutalement privées de l’Eucharistie et tenues à l’abstinence sexuelle dans leur second mariage en toutes circonstances et pour toujours, mais que chaque cas devait être traité avec discernement et bienveillance, en tenant compte également de la conscience de chacun.
Les opposants du Pape
Ce que ces opposants exigent du Pape, c’est une application stricte de la lettre de la Loi. C’est exactement ce à quoi Jésus s’est opposé toute sa vie lors de ses rencontres avec certaines élites religieuses de son temps, engageant ses disciples à se méfier du « levain des pharisiens ».
Quel est le style de réforme de l’Église de François ? Le Pape n’est pas un révolutionnaire qui veut changer la doctrine de l’Église. Ceux qui le connaissent bien depuis des décennies disent qu’il n’est pas un théologien progressiste, mais plutôt qu’il est miséricordieux. La miséricorde est la clé pour comprendre sa personnalité et sa réforme.
Ce Pape ne change pas les normes écrites, il ne détruit pas non plus les structures extérieures, mais il transforme la praxis et la vie. Il ne change pas l’Église de l’extérieur. Au contraire, il la transforme beaucoup plus profondément, spirituellement, de l’intérieur. Il la transforme par l’esprit de l’Évangile ; c’est une révolution de la miséricorde. Dans son cas, ces mots ne sont pas de simples phrases pieuses et creuses. Sa réforme a le moyen de changer l’Église et de la ramener au cœur du message de Jésus plus profondément que bien des réformes passées.
Dans l’Épître à Philémon, nous lisons une histoire paradoxale. L’apôtre Paul a pris soin de l’esclave fugitif Onésime. Il l’a baptisé et le renvoie maintenant à son maître chrétien, Philémon, en ajoutant que l’esclave continuera à le servir. Cependant, Philémon doit aussi se rappeler qu’Onésime est maintenant son frère dans le Christ.
Un catholicisme sans christianisme
Ainsi, le christianisme ne préconise pas un renversement révolutionnaire violent du système de l’esclavage à la façon de la rébellion de Spartacus. Il appelle plutôt à la création d’un climat moral de fraternité humaine et de respect mutuel de la valeur de chaque être humain, dans lequel le système esclavagiste doit à terme rendre son dernier souffle.
Aujourd’hui, la mentalité d’une certaine forme de «catholicisme sans christianisme» (qui considère Donald Trump comme son chéri) nous rappelle les scribes et les pharisiens de l’époque de Jésus. Comment vivre avec ce poids de l’histoire de l’Église, garder le respect de l’Église, sentire cum ecclesia, et la fidélité à l’Évangile et puiser la force dans la promesse de Dieu de nous donner un « avenir plein d’espérance » ?
Le Pape François ne change pas les dogmes et ne remet pas non plus en cause les sections des documents de l’Église qui représentent des « produits » ayant expiré il y a longtemps et qui sont maintenant toxiques et nocifs. De même, le Concile Vatican II n’a pas officiellement annulé, par exemple, les indéfendables imprécations de Pie IX concernant la liberté de conscience, de la presse et de la religion (le tristement célèbre Syllabus des erreurs). Vatican II a plutôt publié un document contraignant (la constitution « Joie et espoir » – « Gaudium et Spes ») qui a fait de ces valeurs, jusqu’alors rejetées par l’Église, une partie intégrante de son enseignement.
Le courage chrétien du Pape François
Par son exemple personnel de courage chrétien, le Pape François nous inspire à ne pas être ni intimidés ni découragés par certains événements dans l’Église. Il nous appelle à agir comme de libres enfants de Dieu, en exerçant de façon responsable la liberté que le Christ nous a offerte et en ne nous soumettant pas à nouveau au joug de l’esclavage de la religion légaliste, comme l’apôtre Paul nous y invite avec force dans l’Épître aux Galates.
Au début de l'”Année de la Miséricorde«, certains d’entre nous avaient quelques doutes théologiques pour savoir si la notion de miséricorde n’interprétait pas l’amour de Dieu un peu trop »d’en haut”. Mais c’est à travers la miséricorde que nous invitons Dieu dans des relations humaines difficiles et douloureuses, non pas comme garant de principes immuables, mais plutôt comme un pouvoir bon, généreux, compréhensif, indulgent et réparateur, capable de transformer l’homme, l’Église et la société.
La ligne horizontale de la «fraternité humaine» dont le Pape a parlé dans la récente encyclique Fratelli tutti a besoin de sa ligne verticale d’amour en tant que miséricorde infinie qui dépasse toutes les frontières humainement concevables ; c’est l’amour sans frontières vers lequel nous ne pouvons nous diriger qu’en tant que but qui ne sera pleinement atteint que lorsque nous serons étreints par les bras de Dieu. Comme la plupart des sublimes paroles de Jésus, cet idéal ne doit pas devenir une «loi». Il doit plutôt rester une impulsion constamment provocante et prophétique.
Or en ces temps où le coronavirus sévit, je ne peux m’empêcher de m’inquiéter d’une autre pandémie, celle du fondamentalisme et du sectarisme. En regardant les partisans catholiques de Donald Trump, je lutte contre la grande tentation du scepticisme : «Le dialogue œcuménique au sein de l’Église catholique» est-il même possible ? Je trouve le dialogue interreligieux, et surtout le dialogue avec des personnes cultivées et sérieuses en dehors de l’Église, tellement plus facile que toute discussion avec les gens qui combinent la religion avec des démarches populistes et nationalistes.
Un grand rêve s’achève en fumée
Pendant un demi-siècle, j’ai vécu un grand rêve : réunir tous ceux qui croient en Christ. Aujourd’hui, pour moi, ce rêve s’achève en fumée. Il y a des différences que je considère comme insurmontables, et ces différences ne sont pas entre les Églises mais plutôt à travers elles. Je ne peux vraiment pas défiler sous la même bannière que les gens qui prétendent avec véhémence que Dieu a créé le monde en six jours, que Moïse est l’auteur des cinq livres de Moïse (y compris les passages concernant sa propre mort), ni avec les gens qui s’opposent à quelque ordination des femmes.
Pour un grand nombre de chrétiens d’aujourd’hui, le contenu positif de la foi s’est vidé. Ils doivent donc trouver leur «identité chrétienne» dans des «guerres culturelles» contre les préservatifs, l’avortement, le mariage homosexuel, etc. Le Pape François a eu le courage de qualifier ce catholicisme réducteur et défini en négatif d’ « obsession névrotique ».
Il est certain que je ne vais pas quitter l’Église où je continuerai à rencontrer des personnes avec de telles opinions et convictions morales à la même table eucharistique. Je suis bien conscient que je suis moi aussi un être humain faillible et sujet à l’erreur. Néanmoins, je suis aux prises avec un doute de taille : n’est-il pas temps d’abandonner les poursuites de l’œcuménisme de « tous les chrétiens » et de se concentrer plutôt sur l’approfondissement d’un œcuménisme fécond (partage, synergie et enrichissement mutuel) entre personnes avisées, aussi bien croyantes que non croyantes ? Certes, nous récitons le même Notre Père et le même Credo. Cependant, je crains que nous vivions dans des univers parallèles inconciliables. La différence se trouve dans le «cœur» des gens.
J’ai la sensation d’être du même bord que les personnes qui suivent les connaissances scientifiques dans tous les domaines où la science est présente, tout en posant de profondes questions éthiques et spirituelles. Le chemin entre le fondamentalisme religieux d’un nombre considérable de chrétiens et le fondamentalisme scientifique tout aussi arrogant des athées militants est souvent étroit et difficile. Je suis néanmoins convaincu que c’est la voie à prendre pour suivre le Christ aujourd’hui.
Éviter un schisme
Nous pourrions peut-être encore éviter un schisme en instituant une sorte de « Concile Apostolique de Jérusalem », dont il est question dans les Actes des Apôtres, et en répartissant les tâches : les uns s’occuperaient des besoins des croyants qui aspirent aux certitudes du passé, tandis que les autres seraient à l’écoute des appels de Dieu dans les « signes des temps » à venir. Je me demande souvent si nous ne nous trouvons pas aujourd’hui dans une situation similaire à celle de l’apôtre Paul, qui a laissé Jacques, Pierre et les autres vénérables apôtres poursuivre leur ministère parmi les Juifs chrétiens, et a conduit la jeune et courageuse chrétienté de l’espace limité du judaïsme à l’oikoumene d’alors, dans un contexte culturel complètement différent. La mission de Paul a donné naissance au phénomène que nous appelons aujourd’hui le christianisme ; un phénomène qui annonce très probablement une sorte de détermination similaire pour franchir les frontières actuelles.
Aujourd’hui, le Pape François nous montre peut-être une telle compréhension de l’Évangile et une telle attitude envers la création et les personnes, surtout celles qui sont en marge, montrant de façon prophétique ce que nous appellerons demain le christianisme. L’identité chrétienne n’est pas enracinée dans l’immobilité mais dans le mouvement de l’Esprit qui agit dans l’histoire pour conduire les disciples de Jésus toujours plus profondément dans la plénitude de la vérité.